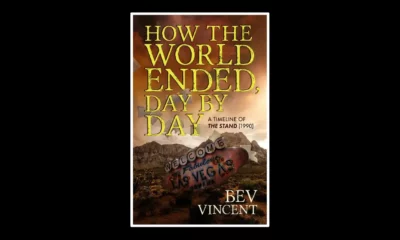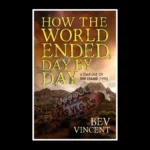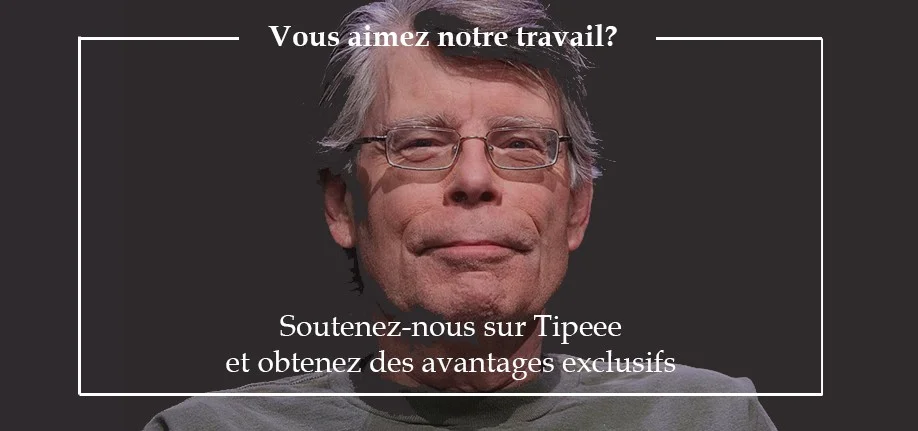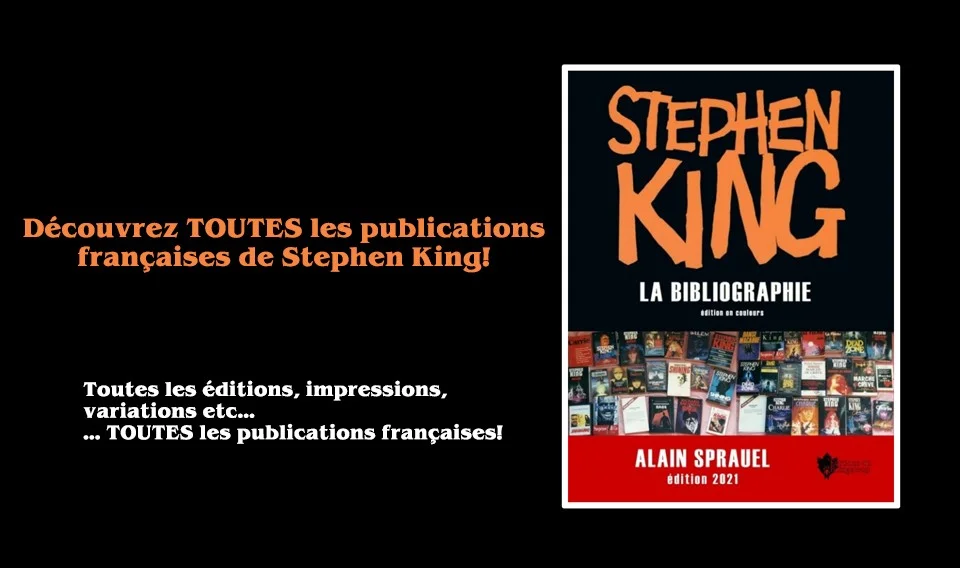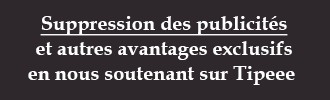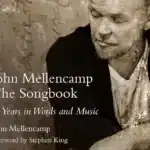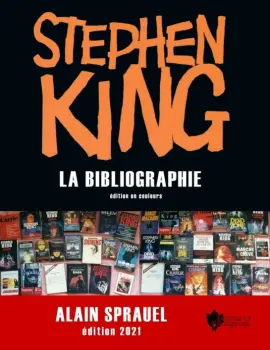DE L’ÉCRIT a L’ÉCRAN
PANORAMA D’UNE MONSTRUEUSE FILMOGRAPHIE
(1ére partie)
(Guy Astic)
Je ne pense pas que Steve ait eu beaucoup de chance sur grand écran « . Clive Barker, lui-même écrivain-cinéaste aux commandes à ce jour de trois longs métrages (Hellraiser, Cabal, Lord of Illusions), est plutôt catégorique dans ce propos de 1995 consacré aux adaptations cinématographiques des livres de Stephen King1. Exprime-t-il ainsi tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ? Peut-être… En tout cas, au vu de la presque cinquantaine de réalisations inspirées du maître de Bangor, grand et petit écrans confondus, le sentiment de gâchis est indéniable, même s’il n’occulte pas les réactions enthousiastes ni les bonnes surprises.
Alors, est-il si aisé que cela de transposer l’univers de King sur une pellicule ? Pas sûr, d’autant que l’intéressé lui-même s’y est cassé les dents :avec Maximum Overdrive (1986), il a commis un film bavard, sans rythme ni aucune maîtrise du montage et du découpage des plans, bien loin de la nouvelle originale, » Poids lourds » (‘Trucks « , Danse macabre, 1978), un texte ciselé, sans fioritures.
Toujours est-il que la matière première ne manque pas et que le filon ne semble pas près de s’épuiser. Pour la seule année 1997, on compte trois réalisations bouclées et distribuées (La Peau sur les os | Thinner, Le Rapace nocturne | The Night Flier, la mini-série TV Shining) et cinq projets d’adaptation en développement (Le Molosse surgi du soleil | The Sun Dog, L’Elève doué | Apt Pupil, Insomnia, La Ligne verte | The Green Mile, Rose Madder). Si la quantité n’est pas gage de qualité, on peut cependant espérer voir sortir du lot quelques réussites. Au reste qu’importe : de l’aveu même de King, » un mauvais film ne peut pas ruiner un livre » ! Subsiste par ailleurs cette formidable dynamique qui entraîne inlassablement les oeuvres de l’écrivain américain dans des projections grand public de plus en plus nombreuses. Pas seulement parce que le nom de King attire les foules de spectateurs et fait recette. Mais surtout parce que ses livres en appellent aux images, sont en phase avec un monde médiatique mêlé, omniprésent, où le lecteur est presque automatiquement (télé)spectateur.
Mieux, on a l’impression que la caméra prolonge la tradition du conte oral qui semble s’imposer pour les histoires de King, tant elles ont une résonance populaire et reposent sur le plaisir évident et immédiat de raconter. Un parti-pris remarquablement mis en scène dans Stand by me de Rob Reiner (l’adaptation de » Le Corps « , Différentes saisons) : au détour d’un récit de » gerborama » inventé par Gordie, le rhapsode en herbe du quatuor d’enfants partis à la recherche d’un cadavre, on perçoit à quel point l’objectif d’une caméra peut restituer, voire intensifier, les émotions naturelles et essentielles éprouvées lorsqu’on écoute sans retenue ni fausse pudeur une histoire à voix haute. En outre, la plupart du temps chez King, cela ressort bien dans les films qu’il inspire, l’intrigue tend vers un événement ou une situation simplement extraordinaires, visuellement exaltants, à partir desquels s’organisent un univers référentiel et inédit, un réseau de personnages héroïques et communs… tous les ingrédients de la comédie (in)humaine à laquelle le public participe étroitement. Les Mille et une Nuits version C’est arrivé près de chez vous en quelque sorte qui suscite, dans l’anonymat des salles obscures ou dans l’intimité – devant l’écran cathodique, une empathie évidente. Et ce n’est pas un hasard si, de plus en plus, les textes de King prennent le format de la mini-série télévisuelle !
Voilà l’orientation d’ensemble susceptible de constituer un fil directeur pour s’y retrouver dans une filmographie qui bat tous les records, les meilleurs comme les pires. Elle ne peut faire ignorer toutefois la nature imprévisible et kaléidoscopique des adaptations du King, qui tient bien sûr au contenu éclectique des oeuvres sollicitées, mais encore aux formes variées choisies pour les transposer. Tout y passe : du téléfilm au long métrage cinématographique, de la mini-série TV au film à sketches, des sequels aux épisodes ponctuels disséminés dans des séries sans rapports directs avec l’auteur. Du reste, cela semble à peine sufisant auregard de l’imaginaire démesuré d’un des écrivains les plus lus au monde. Et nombreuses sont les autres expressions artistiques qui relèvent le défi de donner vie à ses récits ou à ses scénarios: le feuilleton radiophonique -entre autres la dramatisation de Simetierre pour la BBC par Gordon House zen février 1997, le clip vidéo (Ghosts de Stan Winston pour Michael Jackson, dont King a écrit le scénario), l’adaptation théâtrale (Misery et Rage par exemple), la comédie musicale (Carrie donnée à Broadway en mai 1988).
Contentons nous des films, il y a déjà fort à faire… et tâchons de ne pas nous égarer sous peine de faire de mauvaises rencontres!
Stephen King et les ‘grands réalisateurs’
L’expression ‘grand réalisateur’ est certes sujette à caution et pourrait masquer des choix reposant sur des critères pas toujours objectifs. Cependant, elle désigne deux catégories de metteurs en scène : les cinéastes d’exception, reconnus comme tels par la presse ou par les milieux professionnels, qui font des incursions ponctuelles et remarquées dans le domaine du fantastique ; les maîtres du genre pour qui le film d’horreur n’a pas de secret – de véritables ‘fearmakers’ pour reprendre le qualificatif de John McCarty 2.
Dans le premier cas, on songe à Stanley Kubrick et au tournage désormais célèbre de Shining (1980). Si le film est une réussite d’un point de vue réalisation, photographie ( le labyrinthe des haies sous la neige, inoubliable !) et performance d’acteurs, il n’a pas fait le bonheur de Stephen King. Loin s’en faut ! Au point de parler de guerre entre les deux S. K., par déclarations interposées et petites phrases assassines surtout du coté de l’écrivain : » Shining ? C’est une superbe voiture, mais dépourvue de moteur » ! Rien de plus logique dès lors à ce que l’auteur du livre entreprenne une nouvelle adaptation, dans une version plus longue (une série télé, 1997) qui permet de respecter la lente montée de la folie chez Jack Torrance et la découverte progressive des dons de Daniel. n procède aussi au recentrage de l’intrigue sur le personnage de l’enfant hanté par Tromal, quelque peu délaissé par Kubrick au profit du père, étoffe également l’espace de l’hôtel Overlook. Bref, le romancier veut un peu plus de chaleur – donc, plus d’imperfection ? – la où le créateur d’Orange mécanique (1971) proposait une mécanique froide et réglée de l’horreur… aux antipodes des » fameux points de pression « 3 évoqués par Stephen King, ces formes de terreur profondément enfouies que le film d’épouvante bouscule et pousse souvent à leur paroxysme.
Côté spécialistes de productions à suspense ou d’épouvante, Kìng est plutôt bien servi et ce, dès le coup d’essai de son premier roman au cinéma. Avec Carrie (1976), Brian de Palma signe un véritable chef-d’oeuvre et, par la même occasion, propulse sur le devant de la scène un jeune auteur dont la carrière paraît rapidement prometteuse. Le réalisateur, déjà remarqué pour avoir dirigé Sisters (1973) et Phantom of the Paradise (1974), bénéficie en la circonstance du travail scénaristique remarquable de Lawrence D. Cohen – qui a eu aussi le mérite de livrer un script satisfaisant pour le monumental ÇA. Transformer Carrie en récit filmique n’a vraiment pas été une sinécure, puisque le texte s’apparente à un collage – un peu comme pour Les Régulateurs (1996) constitué de témoignages, d’articles de journaux et de comptes rendus divers (surtout scientifiques). Le résultat est là : un film culte, avec une longue séquence finale mémorable, qui surpasse le livre – pour lequel d’ailleurs, lors de sa conférence à 1’Université du Maine (Bangor) le 11 octobre 1996, King n’a pas eu des mots tendres : » c’était un livre jeune écrit par un jeune écrivain. Il me fait penser à un gâteau préparé par un débutant, assez succulent, mais bosselé et brûlé sur le dessus « .
L’année 1983 est bien remplie pour King : deux films d’auteur – excusez du peu ! – honore ses écrits. D’abord Dead Zone du sulfureux David Cronenberg, auteur déjà de Chromosome 3 (1979), de Scanners (1981) et du récent Videodrome (1983). Si, a priori, les univers de King et de Cronenberg ont peu de chance de se croiser – l’un étant en fait, sous des dehors extravagants, plus conservateur que l’autre, Dead Zone recèle tout de même des connexions solides, notamment en ce qui concerne la conspiration politique, proche des ambiances paranoïaques et terriblement oppressantes chères au cinéaste canadien. De plus, Cronenberg distille avec mesurel’argument spectaculaire – le don de Johnny Smith incarné par un Christopher Walken inspiré, assurant un équilibre parfait entre les séquences de prémonition et le quotidien , peu à peu détraqué par la faculté contre-nature du protagoniste. À ce titre, il respecte quasiment à la lettre la ligne narrative du roman de King. Incontestablement, à l’instar de l’écrivain lui-même, le futur réalisateur de La Mouche est à l’aise pour filmer les affres psychologiques et suggérer l’enfer de la chambre mentale dans laquelle Johnny Smith, en avance sur son temps, s’enferme. La malédiction à l’échelle humaine fonctionne à plein, engendrant un film aussi impressionnant que le livre .
La même année donc, John Carpenter décide d’adapter Christine. Un film de teenagers, dont la vedette n’est pas un tueur à l’arme blanche façon Michael Myers dans Halloween (1978), mais une Plymouth Fury rouge, modèle 1957, de chez Chrysler. Si l’expressivité esthétique du long métrage repose sur la mise en scène de la voiture diabolique – des plans, des éclairages et des angles de vue captivants dûs en partie au directeur de la photographie Donald M. Morgan, sa force dramatique émane du traitement que Carpenter réserve à la métamorphose psychique de l’adolescent envoûté par le véhicule : tout commence comme dans un épisode de Happy Days transposé à Pittsburgh – Arnie Cunningham oblige ! – et se poursuit dans une progressive et implacable escalade de la terreur. Au demeurant, le scénariste Bill Philips a resserré l’argument narratif du livre, évacuant la figure encombrante du spectre de Roland Le Bay pour conférer à la voiture une autonomie encore plus inquiétante. Ce que du reste Stephen King approuve, subjugué par la préférence accordée à la détérioration mentale aux dépens des représentations physiques peu ragoûtantes (gore et compagnie…)3. Encore une fois, King triomphe sur grand écran, sans effets tape-à-l’oeil ni hémoglobine à gogo !
I1 faut attendre 1990 pour voir un autre grand nom du cinéma d’horreur s’emparer d’un roman de King et en tirer pour ainsi dire la substantifique moelle. En adaptant La Part des ténèbres, George Romero s’attaque directement au mythe bifronce King/Bachman en filmant le face-à-face Thad Beaumont/George Stark. En l’occurrence, on peut parler de volte-face puisque les deux rôles sont tenus par le même acteur, Timothy Hutton. Une option de jeu plutôt en rupture avec le roman, étant donné que l’écrivain et son pseudonyme increvable, ‘Un Type pas très Sympa’ comme l’indique l’épitaphe, n’ont guère de choses en commun, sinon l’essentiel : la fiction romanesque. Par ailleurs, aux antipodes de La Nuit des morts vivants (1968) et dans la lignée intimiste de Incident de parcours (Monkey Shines, 1988), Romero réduit les scènes d’action au strict minimum, multiplie les dialogues, soigne les prises de vue liées à la symbolique psychopompe des moineaux – au point de donner à voir une séquence d’anthologie digne du final au mur de briques dans Le village des damnés (1960) de Wolf Rilla : des milliers d’oiseaux perforent les cloisons du bureau où s’affrontent Thad Beaumont et son alter ego maléfique, et finissent par désintégrer littéralement George Stark. Une envolée ultime pour une image surréaliste inoubliable… insufflée par un romancier en état de grâce.
Stephen King paraît en définitive gâté par les grosses pointures du cinéma hollywoodien ou celles d’un cinéma (indépendant) plus spécialisé. Dans l’ensemble, ces réalisateurs adoptent un profil bas quant à l’horreur directe ; ils préfèrent restituer la peur latente, la sensation de déstabilisation intérieure souvent décrites dans les livres de King. Ils semblent surtout faire leur le message de l’écrivain, inscrit en filigrane dans la plupart de ces fictions passées à la postérité dans le septième art : » nous inventons des horreurs pour nous aider à supporter les vraies horreurs. Armés de la formidable capacité d’invention de l’esprit humain, nous agrippons les choses qui nous divisent et nous détruisent et tentons de les transformer en outils – dans le but de les démonter. « 4
Toutefois, d’autres adaptations pour le grand écran ne font pas dans la dentelle : elles puisent allègrement dans le fonds monstrueux des écrits du ‘Bestsellasaurus Rex’ (George Beahm, The Stephen King Story, New York : Warner Books, 1994), se soucient peu, ou dans une moindre mesure, de la dimension psychologique, privilégient par contre les manifestations spectaculaires de l’impensable et de l’innommable. Bref, elles passent en revue le catalogue inépuisable des articles du Mal chers à Stephen Kíng, qu’ils provoquent les réflexes bruts d’écoeurement ou qu’ils triturent les points de pression phobique. Pour pasticher le titre d’une anthologie du fantastique en douze émissions présentée par le Maître lui-même en 1990 (distribuée en video par ALPA International), THIS IS HORROR…
L’épouvanthologue King, version grand écran
Comme l’illustrent les différentes figures horrifiques incarnées par Mr. Bob Gray – alias Grippe-Sou le Clown – dans ÇA, Stephen King ne lésine pas quand il s’agit de donner corps aux pires cauchemars, aussi nombreux soient-ils. Spectateur précoce, puis expérimenté, de monstruosités en technicolor ou en cinémascope, il ne cesse de les réinvestir dans ses textes, tout en veillant à renouveler et à moderniser sa petite boutique des horreurs. Cela ne se fait pas cependant au détriment de son écriture consciente de la hiérarchie des effets produits par le récit qu’elle met en forme : » la terreur au sommet, l’horreur en dessous, et la révulsion tout en bas « . Ce qui n’empêche pas King d’avouer : » Je reconnais que la terreur est la plus raffinée de ces trois émotions […] et je m’efforce donc de terrifier le lecteur. Mais si je me rends compte que je n’arrive pas à le terrifier, j’essaie alors de l’horrifier ;et si ça ne marche pas non plus, je suis bien décidé à le faire vomir. Je n’ai aucune fierté. « 5
Or, dans cet ordre décroissant de finesse, que l’écrivain n’hésite pas à parcourir dans les deux sens, la répulsion n’a-t-elle pas tendance, projetée sur un écran géant, à occulter les niveaux plus subtils du genre horrifique ? En d’autres termes, les adaptations du King monstrueux arrivent-elles à concilier shock horror et terreur ? Se préservent-elles d’une mise en scène facile, démonstrative, bâtie avant tout sur les effets spéciaux, les maquillages ou les plans et les hors-champs spectaculaires, conventionnels à force ?
À considérer certaines créatures puisées dans le bestiaire de King pour être propulsées sur un plateau de tournage, les réponses sont partagées, même si le penchant à la sur-représentation de l’abominable ou la surenchère en matière de violence ont vite fait de s’imposer. Cujo (1983), dirigé in extremis – à la suite de la défection de Peter Medak – par Lewis Teague, est ainsi un film direct, tourne vers la monstration a l’état pur : un saint-bernard plein cadre, qui n’a rien à voir avec Belle (celle de Sébastien) ;c’est plutôt la Bête plongée, à la suite d’une morsure de chauve-souris, dans une folie furieuse meurtrière. Or, tout en étant moins ambitieux que Dead Zone réalisé la même année, ce long métrage frappe juste et fort, sans tomber dans l’excès ou tourner au grand-guignolesque. La dernière demi-heure, où Donna et son enfant sont piégés dans la cour d’un garage isolé à la campagne, semble l’aboutissement logique du cercle familial qui se détériore peu à peu dans la première partie. L’affrontement ultime avec le molosse est d’ailleurs un tour de force visuel de chaque instant. Secondé par un certain Jan de Bont (Speed, Twister) à la photographie, Lewis Teague filme l’horreur en pleine lumière, jouant de l’éclairage solaire avec presque autant d’agaçante suggestivité que dans Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (1974). Les circonvolutions de sa caméra autour de la voiture assiégée, dont les vitres et le pare-brise maculés de sang et de bave brouillent souvent le champ de vision, sont éprouvantes, jouant de la présence-absence du chien avec un suspens soutenu. Le mouvement d’ensemble entraîne l’héroïne, ainsi que le spectateur, dans une sorte de spirale de la régression, où seul compte l’instinct primitif de survie : dans un effet de miroir saisissant, la blonde Donna – interprétée par une Dee Wallace Stone impressionnante – voit son corps se dégrader autant que le pelage et le faciès souillés du saint-bernard. Comme s’il n’y avait qu’une issue : accepter la perte (temporaire) de son humanité pour triompher du mal à l’état brut.
Un film noir donc, sans concession ni complaisance. Pour la petite histoire, King avait proposé un script refusé aussitôt – son premier pour un long métrage – qui enfonçait le clou, en faisant mourir le fils Trenton. Extrême ! Trop pour la Warner. Tant pis !
La suite, en ce qui concerne notamment les monstres mi-hommes, mi-bêtes, est plus décevante. Et Stephen King a une grande part de responsabilité dans ces ratages cinématographiques. En proposant le scénario Silver Bullett de son livre-calendrier Cycle of the Werewolf (traduit par La Nuit ou L’Année du loup-garou), l’écrivain met en route un projet qui aboutit à un film pitoyable. D’abord, en raison du texte qui, de l’aveu même de King dans sa préface, est » un enfant mort-né » ;ensuite, parce que Hurlements de Joe Dante, Le loup-garou de Londres de John Landis et Wolfen de Wadleigh ont balisé le terrain et laissent une marge de manoeuvre étroite pour une nouvelle réalisation condamnée à faire aussi bien. Ce n’est pas le cas pour Peur Bleue (1984) : ce premier long métrage du jeune Californien Dan Attias ne procure qu’un sentiment de déjà vu, en moins bien ! Les scènes de carnage ou de métamorphoses ne surprennent guère . Seule petite originalité : la recherche d’un(e) borgne qui serait la créature – en l’occurrence, c’est le prêtre Lowe. Autre rare satisfaction : la voix-off féminine qui fait le récit des événements survenus dans le passé à Tarkers Mills, trace de la manie de conteur dont King ne peut pas se défaire et de sa tournure d’esprit nostalgique des peurs enfantines, celles d’un temps trop tôt disparu.
I1 n’y a même pas cela pour sauver La Nuit déchirée (Stephen King’s Sleepwalkers, 1991). Le script original de King repose sur une intrigue bien mince, des félidés vampires qui soutirent leur énergie vitale de victimes innocentes ou vierges. Pour défendre leur film, le scénariste et son réalisateur Mick Gams – qui s’est rattrapé par la suite avec le tournage du Fléau – se réfugient derrière un argument peu crédible au vu du résultat : selon eux, ils rendent hommage aux films de monstres des années 50 et un peu avant. Pourtant, Mary Brady, mi-femme mi-chatte ne fait guère le poids face à Irena Dubrovna, la Féline de Maurice Tourneur (Cat People, 1942) et même comparée à Nastassja Kinski dans le remake de 1982 de Paul Shrader. On a surtout l’impression qu’entre les doigts tranchés, les corps mutilés ou les matous éventrés, le duo King/Garris ne s’est attaché qu’à ménager des apparitions pour leurs guest stars : Mark Hamill (Luc Skywalker), Tobe Hooper, Joe Dante, John Landis, Clive Barker. Ça fait pas très sérieux !
Arrêtons de noircir le tableau. II reste à évoquer un film d’affreuses bêbêtes, auquel King n’a pas apporté de contribution directe, sinon sa nouvelle : « Poste de nuit » (Danse macabre). La créature du cimetière (Graveyard Shift, 1990)6 de Ralph Singleton prend le pan de transposer en une heure trente la dizaine de pages racontant la nuit atroce d’une équipe de nettoyage industriel confrontée à des rats mutants. John Esposito a réussi à allonger la sauce sans que cela ne paraisse pas trop surfait – ce qui n’est pas donné à tout le monde, n’est-ce pas Monsieur Harry Alan Towers, scénariste laborieux de The Mangler ! À l’arrivée, le film s’avère une série B honorable, suffisamment effrayante avec les créatures conçues et animées par Gordon Smith (L’Échelle de Jacob), dans la veine des rats géants de Soudain, les Monstres (The Food of the Gods, 1975) de Bert I. Gordon. Une production que James Herbert, le Pape des Rats Mutants, ne renierait pas lui-même !
Après les monstruosités à quatre pattes, il faut faire un sort aux objets inanimés qui, soudainement, prennent vie. Afin de garder notre admiration intacte pour King, point n’est besoin de s’attarder sur Maximum Overdrive, une débauche d’instruments électriques, de robots ménagers et d’engins mécaniques tueurs qui ne provoquent chez le spectateur que des rires, des soupirs ou des bâillements. Plutôt mauvais signe !
The Mangler(1994) de Tobe Hooper est un peu mieux inspiré, mais ne comble guère les attentes du public – d’ailleurs, le réalisateur américain ne livre pas des films à la hauteur de sa réputation ces dernières décennies (Invaders from Mars, 1986 ; Combustion spontanée, 1990). Une fois de plus, c’est une nouvelle extraite de Danse macabre qui passe au grand format et subit des dommages sans réel intérêt ! Alors que » La presseuse » se présente comme un texte nerveux, une saillie épouvantable qui n’a pas d’autre prétention que d’entrouvrir une porte sur la phobie du corps broyé une sale plaisanterie en quelque sorte, le film traîne en longueur, souffre de raccrocs scénaristiques grossiers. Par exemple, l’inspecteur Roger Martin évoque dans le court récit une ancienne affaire de réfrigérateur diabolique que lui rappelle l’atroce accident de la blanchisserie. La version cinéma a voulu intégrer cet épisode dans le présent de l’enquête de façon à créer une atmosphère maléfique, semble-t-il – comme l’indiquent les éclairs bleus qui passent de la repasseuse à la glacière. En vain, puisque la lutte avec le frigidaire infernal paraît une parenthèse inutile et fait se relâcher la tension suscitée par la gigantesque presse. Montrée, elle est de trop ; simplement racontée, elle aurait excité l’imagination et renforcé l’inquiétude poisseuse qui suinte dans les locaux surchauffés et moites de l’usine. Le film jouit tout de même d’une entrée en matière convaincante, l’objectif de la caméra examinant sous toutes les coutures la Hadley-Watson trônant tel un Moloch au milieu du hangar. D’emblée aussi, le personnage du patron est remarquablement campé par Robert Englund (Freddy Krueger en chair et en os !) : borgne, harnaché dans un équipement de ferraille qui l’aide à marcher, Gartley incarne en fait le double diabolique de la machine. Par la suite, le rythme devient parfois poussif, Robert Englund en fait trop, la terreur s’essouffle, l’horreur révulsive gagne… Sans doute est-ce la trajectoire attendue pour l’adaptation d’une nouvelle sans réelle finesse. Comment peut-il y en avoir quand on parle, sans ironie ni autre forme de distanciation, d’êtres humains broyés ou laminés ?
La dernière escale dans ce voyage au pays des monstres créés par le docteur King prend des tournures moins bestiales. L’horreur a cette fois visage humain. Mais les apparences sont trompeuses et le Mal n’en est que plus virulent.
On connaît les rapports privilégiés qu’entretiennent le fantastique et le motif de l’enfance sous la plume de Stephen King. Deux films les mettent en images, en choisissant de montrer les transformations inhumaines de faces d’ange, que la petite Regan (Linda Blair) habitée par le Diable dans L’Exorciste (1973) a sans conteste inspirées – King souligne à plusieurs reprises que le chef-d’oeuvre de William Friedkin a marqué de son empreinte sa propre littérature. En 1984, Mark Lester tourne Firestarter (Charlie), le récit d’une fillette ayant le don de pyrokinésie – Charlene MacGee est le troisième enfant, après Came et Daniel (Shining), à posséder des capacités extra-sensorielles. Si le film est proche du livre, il ne fait pourtant pas le bonheur de King qui le compare à un plat de cafétéria sans saveur7. La toute jeune Drew Barrymore – mémorable depuis en victime spectaculaire dans Scream de Wes Craven ne parvient pas à donner une aura suffisamment inquiétante à son personnage. De plus, la perspective paranoïaque liée aux agissements de l’état et de ses services secrets manque d’ampleur, les effets pyrotechniques s’imposant comme la plus grande réussite du film. Ce qui est loin de provoquer les réactions ardentes du public, le comble !
Avec la figure de l’enfant malfaisant dans Simetierre (1989) de Mary Lambert, on atteint le paroxysme de l’horreur. Pas parce que le gamin est surdoué ou possédé, mais parce qu’il est rappelé d’outre-tombe et que son retour de mort-vivant le change en machine à tuer immonde. Un événement d’autant plus choquant que le spectateur a eu le temps de se familiariser avec le tendre Gage et de se scandaliser de sa mort.
Le film est un double événement en soi : pour la première fois, Stephen King rédige le scénario d’un de ses romans pour le cinéma. Il modifie peu son texte, travaille avec rigueur pour élaguer des passages – il écarte par exemple le personnage de Steve Masterton (tant pis pour l’auteur de Manitou ou de Tengu à qui il était ainsi fait allusion), soigne les apparitions du spectre de Victor Pascow. Plusieurs changements propices en somme à l’expression appuyée de l’enfermement de la famille Creed dans l’engrenage de l’abomination. Par ailleurs, c’est la première et dernière fois qu’une femme adapte King. Mary Lambert récidivera en 1992 avec Simetierre 2, mais la sequel n’a rien à voir avec le premier opus. Elle a su en tout cas ménager la terreur, faire jaillir une intensité visuelle des espaces tragiques et symboliques retenus (le cercle du Pet Sematary et l’au-delà, le cimetière des Micmacs ;la ligne droite, impitoyable, de la route 15 qui coupe le paysage et fauche nombre de vies)… sans oublier les scènes gore – entre autres, celles de l’enfant au scalpel – qui illustrent au mieux la phrase serinée par le vieux Jud : » n y a des états pires que la mort « . Bref, un film éprouvant qui restitue la position du narrateur, pour qui, » à mesure que l’on s’enfonce plus profondément dans les ténèbres de l’épouvante, une espèce d’effet exponentiel entre en jeu. » (début de la deuxième partie du roman)
Pour terminer ce tour d’horizon, place aux malédictions qui avilissent les hommes, les poussent à commettre des actes barbares et les défigurent au sens propre.
Dans Le Bazaar de l’épouvante (1993) de Fraser Heston, Leland Gaunt (impeccable Max von Sydow), s’en donne à coeur joie pour dénaturer les hommes et faire remonter à la surface leurs instincts les plus vils et les plus destructeurs. Le plaisir pris par le Diable à visage d’antiquaire est évident : il goûte en esthète la folie meurtrière qui s’empare de la ville de Castle Rock – on songe à la sauvage altercation qui voit s’entre-tuer Wilma et Nettie à coups de hachoir et de couteau de cuisine, le tout accompagné par 1’Ave Maria de Schubert qu’écoute Gaunt avec délice, non sans ironie ! Sans compter les innombrables jeux de mots sur le feu et l’enfer que la » chose gauntesque » laisse échapper – cela tourne d’ailleurs au procédé. Le réalisateur a certes su concentrer son attention sur le processus de dégradation et d’implosion de la communauté, sans toutefois aller aussi loin que le romancier : la spirale apocalyptique qui emporte le récit jusqu’aux gunfights interminables et aux explosions répétées ne transparaît pas avec toute sa virulence dans les images. Fraser Heston semble avoir plutôt privilégié l’ambiance paranoïaque – Ed Harris en shérif apporte une contribution de poids en la circonstance, digne de celle d’un épisode de Twilight Zone (Les Monstres de Maple Street) souvent cité par Stephen King. Donc, par rapport au texte, la violence est réduite à sa plus simple expression. Peut-être un choix motivé par la durée du film (moins de 120 minutes). À ce titre, il serait intéressant de comparer le produit distribué dans les salles avec la version longue (pas loin d’une heure supplémentaire) diffusée par la chaîne TBS le 22 mai1996 .
La principale entorse du film – pouvait-il en aller autrement ? – vient du fait qu’il n’est pas en mesure de signifier la place qu’occupe le livre dans l’oeuvre de King. Pour ce dernier, Bazaar représente un aboutissement, une apothéose macabre : le récit de la fin de toute une époque, celle où Castle Rock régnait dans son imaginaire, une ville fictive du Maine d’où tout partait et vers laquelle pas mal d’histoires revenaient. Ainsi dans le roman, King s’ingénie à mettre en valeur des endroits, des personnages ou des événements survenus à Castle Rock, qui sont familiers au lecteur immergé dans l’univers du maître de Bangor. En vrac se rappellent à son souvenir Dead Zone, Cujo, La Part des ténèbres, Le Corps, Le Molosse surgi du soleil, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, Le policier des bibliothèques. Autant d’allusions que le film passe sous silence, préférant les clins d’oeil cinématographiques, à La Malédiction (1976) de Richard Donner par exemple8. Par conséquent, le long métrage est une adaptation d’un livre de King parmi d’autres, comptant pour elle-même, là où le roman est le point d’orgue de toute une production. Un décalage incommensurable !
Plus récemment, Tom Holland (Vampires, vous avez dit vampires ?, Jeux d’enfant) s’est attaqué à La Peau sur les os de Richard Bachman, la terrible histoire de Billy Halleck, un avocat obèse qui, à la suite d’une malédiction, ne cesse de maigrir s’approchant dangereusement du point de non-retour. Thinner (1996) s’inscrit donc dans la veine horrifique pure, insistant sur la déchéance physique (avec l’aide de Greg Cannom, maquilleur hors pair oscarisé pour Dracula de Coppola) et sur les sortilèges maléfiques.
En principe, lorsqu’un réalisateur décide de porter à l’écran un texte du pseudonyme de King, il doit s’attendre à ce que la bonne conscience américaine en prenne un coup, car Bachman ne mâche pas ses mots et s’autorise des sorties que son créateur n’assume pas toujours sous son véritable nom. Ainsi, dans La Peau sur les os, en même temps que le sort jeté par Tadzu Lempke décharné le bon gros père de famille, les valeurs pourrissent : celles de la justice, de la fidélité conjugale, de la chanté (chrétienne si possible !), de la bourgeoisie d’une petite ville – Fairview (Connecticut) cède la place dans le film à Camdem (Maine). Une trajectoire quelque peu édulcorée dans la version que propose Holland, où les effets spéciaux, qui tournent à l’exhibition d’une ménagerie des horreurs, ne véhiculent pas réellement le mauvais goût moral. Par ailleurs, le film s’essouffle vite, à l’instar du livre au demeurant. Dans les deux cas, l’idée initiale est effroyablement lumineuse, radicalement affreuse ;mais il est difficile de la nourrir jusqu’à son terme sans tomber dans le ridicule puisqu’elle s’apparente à une farce malsaine. Et la tourte salvatrice dans laquelle passe le sortilège fait un peu gag : c’est un produit light égaré dans une fiction a priori lourde d’horreur et de répulsion. Bachman et Holland se sont trompés de régime. Sans mauvais jeu de mot, on reste sur sa faim !
Enfin, actualité oblige il faut mentionner The Night Flier réalisé par le jeune Mark Pavia. Ce film réalisé en 1997, et distribue en principe au second semestre de l’année, marque l’arrivée sur le grand écran d’un King vampirique. Quoi de plus normal en ce centenaire Dracula ! Basé en effet sur la nouvelle « Le Rapace Nocturne » (Rêves et Cauchemars), le film raconte la traque par le reporter Dees d’un aviateur sanguinaire (un dénommé Renfield, l’illuminé dans Dracula de Bram Stoker !) aux commandes d’un Cessna dont la soute sert de cercueil. On attend surtout de voir comment le metteur en scène donne corps à la vision hallucinante d’un vampire, dont le journaliste ne voit dans le miroir des W.C. que la pisse rouge qui se matérialise au contact de la porcelaine blanche ! Une image d’anthologie ! En tout cas, le magazine Fangoria parle d’une des meilleures adaptations de King depuis Misery – on n’est pas tout à fait dans le même registre, mais bon…
L’épouvantable King sur grand écran, c’est un feu d’artifices permanent, qui éclate à intervalles réguliers (presque chaque année), mais les pétards mouillés ne manquent. Qu’ils soient mal préparés par les différents artificiers, que le terrain choisi pour le tir (en l’occurrence les livres eux-mêmes) soit miné dès le départ… ou un peu des deux.
En revanche, un autre spectacle, moins racoleur, ne connaît pour l’instant aucun raté : il est imaginé à partir des textes de King sans autres héros ou créatures que des enfants, des hommes ou des femmes face à leur conscience, leurs obsessions, leurs regrets ou leurs blessures anciennes.
King sans monstres… ou presque.
Pour évoquer Stephen King, les mauvaises langues parlent de » gratte-papier diarrhéique » et brandissent l’épouvantail de la paralittérature, ce repaire des bavards impénitents. C’est oublier que l’écrivain américain a redonné ses lettres de noblesse à l’imaginaire populaire, sans renoncer aux ramifications symboliques, psychologiques, religieuses ou mythiques qui travaillent en profondeur l’histoire simple et directe en surface. Une tension ‘text/subtext’ – que j’évoque dans ce volume à propos de Rêves et cauchemars – immédiatement perceptible dans les récits dits intimistes et admirablement prolongée à l’écran par des réalisateurs réceptifs à la complexe sensibilité du magicien de l’horreur. Notamment Rob Reiner (Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride), dont le cadre de création et d’inspiration est au premier abord fort éloigné de l’univers violent de King. Pourtant, il a été conquis :
» Je ne suis pas un fana d’horreur, mais je ne pense pas que l’intérêt de l’œuvre de Stephen King soit là.C’est vrai que la plupart des gens pensent que Stephen King obtient un si grand succès parce qu’il touche au gore et à l’horreur. Mais ses livres touchent à quelque chose de plus profond. En les étudiant de plus près, vous découvrez que King s’intéresse énormément à la psychologie des personnages, aux rapports qu’ils entretiennent entre eux. Et adapter un de ses romans devient alors passionnant. Des écrits de Stephen King émane une grande chaleur. « 9
II n’est pas étonnant dès lors de voir Rob Reiner impliqué dans quatre adaptations sur cinq qui mettent en vedette les textes plus intériorisés de King. Il réalise Stand by me en 1986 ( » Le Corps « , Différentes saisons), Misery en 1991 ; il participe, par le biais de sa maison de production Castle Rock Entertainment, au projet Dolores Claiborne (1994) dirigé par Taylor Hackford et à celui de Frank Darabont, Les Évadés (1994) inspiré de » Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank » (Différentes saisons). L’autre tournage concerne Apt Pupil ( » Un élève doué « , Différentes saisons) dont la réalisation échoit en 1997 à Bryan Singer, remarqué pour Usual Suspects.
Nombreux sont les traits communs qui rassemblent ces films et favorisent leur impact. D’abord la nature des liens d’amour ou de haine qui rapprochent les personnages dans chacun des cas. L’intensité ne se trouve pas alors du côté des représentations horrifiques, mais dans les échanges humains tout en force et en nuance. Les dialogues sont dès lors la pierre de touche des adaptations. Abondants, ils focalisent en partie l’attention du spectateur, l’image n’étant très souvent qu’un support ou l’aboutissement de paroles bouleversantes – à un moindre degré pour Misery où les actes forcenés de Annie Wilkes se passent souvent de commentaires. Les réalisateurs ont restitué avec justesse et émotion le poids des mots (les serments dans Stand by me) ou des non-dits (Dolores Claiborne), les drames de la parole condamnée (Les Évadés), vociférée (Misery), ambiguë (le jeune Todd Bowden fasciné par les discours de Dussander dans Apt Pupil). Dans cette perspective, l’utilisation de la voix-off est un élément dramatique, ainsi qu’une chambre d’écho psychologique, particulièrement bien exploités dans ces longs métrages. On songe au récit de Gordie dont la voix propulse ses camarades – Vern, Teddy et Chris – dans un monde imaginaire et le spectateur dans une séquence cinématographique enchâssée (le concours des mangeurs de tartes) ; la reconstitution de l’évasion de Andy Dufresne (Tim Robbins) avec, en fond, la voix de Morgan Freeman, est également mémorable. Comment ne pas réagir aussi à la confession de Dolores Claiborne sur un dictaphone, pour sa fille en partance vers l’intérieur des terres : la fameuse scène du meurtre le jour de l’éclipse gagne en expressivité. Au passage, voilà le seul moment où le film coïncide avec le point de départ du roman : l’interview enregistrée de la femme soupçonnée d’avoir poussé Mrs Donovan dans les escaliers. Dans Misery, ce sont les mots écrits qui assument la fonction d’invoquer les événements passés (entre autres, le journal d’Annie relatant tous ses ‘exploits’ macabres, dont les phrases résonnent dans la tête de Paul Sheldon).
Par ailleurs, l’inscription spatio-temporelle oeuvre de façon identique. Elle suscite un univers exagérément délimité. Les lieux sont précis, souvent réduits à une seule localisation et s’apparentent à des endroits fermés sur eux-mêmes (Little Tall Island dans Dolores Claiborne), voire carcéraux (Les Évadés, Misery, la prison dorée de Santo Donato pour Dussander dans Apt Pupil). Les échappées sont rares, les ouvertures souvent ultimes, comme le Pacifique à la toute fin des Évadés. Même dans Stand by me, l’aventure en plein air a des allures de marche forcée vers un objectif redouté. Symboliquement, les enfants suivent les rails ferroviaires, une voie toute tracée, pour reprendre ensuite le chemin du retour vers Castle Rock inchangé. La boucle est bouclée, le quotidien reprend le dessus. Pour être juste cependant, ils ont parcouru un itinéraire intérieur et ont franchi les barrières du temps : la quête et la découverte du cadavre leur ont procuré une maturité précoce et plonge Gordie adulte dans une nostalgie telle qu’elle le pousse à raconter ces journées d’automne.
Les films décrivent des bouts de monde enlisés dans une chronologie qui joue le plus souvent un rôle déterminant. Les réalisateurs souhaitent de toute évidence rendre le spectateur sensible au rythme temporel, de sorte que son » oreille écoute battre le coeur du temps » (Thomas Mann). Aussi leur bande son est particulièrement soignée, convoquant les airs d’un passé proche (la chanson-titre Stand by me), des musiques lancinantes. Dans Misery, Annie passe toujours les mêmes disques : des mélodies rayées pour un esprit déraillé, incarnant la roue du temps qui broie l’écrivain séquestré et le plonge dans une atroce intemporalité. Dans Les Évadés, les mélodies passées dans la prison ou la bande originale du film témoignent du temps suspendu entre les murs et marquent le décalage croissant avec le monde extérieur qui n’attend pas, se modernise. Autre traitement récurrent du temps : le flash-back, déjà largement exploité par King dans sa prose jalonnée d’analepses répétitives. Visuellement, il permet bien Sûr de jouer sur les contrastes (couleurs, éclairages, époques, sons différents) ; il favorise surtout la remontée dans l’inconscient (la fille de Dolores Claiborne se souvient ainsi d’une expérience traumatisante avec son père) et le retour vers des moments clefs à partir desquels le présent est réagencé. Une façon de procéder à une double lecture du réel ! Par contre, dans Misery, le flash-back brille par son absence, Rob Reiner voulant peut-être suggérer ainsi qu’il n’y a pas d’échappatoire pour Sheldon et sa tortionnaire, même dans le passé : leur histoire va de l’avant, inexorablement, vers la nouvelle aventure de Misery Chastain dont le terme marquera l’issue (tragique) de leur face-à-face.
En définitive, ces adaptations captent la quintessence de l’oeuvre de King vouée à l’exploration du coeur et de l’esprit humains, quitte à descendre dans les soubassements les plus obscurs, à nous faire découvrir des champs de conscience effarants. L’écrivain américain est un arpenteur de l’intimité tour à tour familière et extrême ; il investit la psyché en ménageant une insoutenable légèreté et une inquiétante étrangeté sans relâche. De fait, c’est dans les films plus intrinsèques que l’ambiguïté atteint sa plénitude, contournant une des impasses ordinaires du cinéma fantastique : l’image dévoile là où le texte suggère10. L’horreur ne vient pas ici de la monstration, mais de l’indétermination et de l’indicible tapis au fond de l’homme. Ce qui pousse par exemple Paul Sheldon (admirable James Caan) à singer les réactions grimaçantes d’Annie Wilkes (Kathy Bates, époustouflante, récompensée par un Oscar et le Golden Globe Award) au point – par un effet de mimétisme durable – de conserver certains de ses stigmates. Dès lors, la frontière entre le bien et le mal devient dangereusement poreuse ; le malaise gagne. Dolores n’abdique-t-elle pas en optant pour le meurtre ? Le jeune garçon de Apt Pupil mesure-t-il les conséquences de sa fascination pour le nazi ? La bande des quatre partie à la recherche d’un corps happé par un train peut-elle sortir indemne d’un défi macabre ? Autant de zones troubles, d’entre-deux moraux que les films de Reiner, Darabont, Hackford et Singer restituent à merveille.
La subtilité existe chez King : certains réalisateurs l’ont rencontrée et en ont tiré le meilleur parti en dégrossissant quelques aspects morbides, les restes d’une complaisance pour les plaies à vif et la violence directe. On ne se débarrasse pas des manies d’un professionnel de l’horreur du jour au lendemain ! Toujours est-il que, sans faire dans la dentelle, King sait aussi travailler avec une finesse indéniable, aussi retorse soit-elle, l’âme humaine. Pour ceux qui en douteraient après avoir vu Misery, Les Évadés , Dolores Claiborne ou Stand by me, point de salut ! Ils passent à côté d’un grand auteur et de films rares.
la suite au prochain numéro…
1 Interview de C. Barker conduite par George Beahm et Howard Wormon, traduite dans Stephen King par George Beahm (The Stephen King Companion), Bruxelles : Claude Lefrancq Éditeur, 1996, p.229. Pour en savoir plus sur Barker cinéaste, lire de Guy Astic, » Clive Barker le Terrifiant « , dossier réalisé pour la rubrique » Phénixscope « , Phénix (Lefrancq), n°42, août 1997.
écrivains les plus lus dans le monde. Et nombreuses sont les autres expressions artistiques qui relèvent le défi de donner vie à ses récits ou à ses scénarios : le feuilleton radiophonique , entre autres la dramatisation de Simetierre pour la BBC par Gordon House en février 1997, le clip vidéo (Ghosts de Stan Winston pour Michael Jackson, dont King a écrit le scénario), l’adaptation théâtrale (Misery et Rage par exemple), la comédie musicale (Carrie donnée à Broadway en mai 1988).
Contentons-nous des films, il y a déjà fort à faire… et tâchons de ne pas nous égarer sous peine de faire de mauvaises rencontres !
2 The Feannakers- The Screen ‘s Directorial Masters of Suspense and Terror, directed by John McCarty, New York : St. Martin’s Press, 198p.
3 S. King, Anatomie de l’horreur, Éditions du Rocher, 1995, p.157.
3 Lire l’interview accordée à Ben Hemdon (1985), in Feast of Fear- Conversations with Stephen King, edited by Tim Underwood & Chuck Miller, New York : Warner Books, p.104-106.
4 S. King, Anatomie de l’horreur, op.cit., p.20.
5 S. King, Anatomie de l’horreur, op.cit., p.34.
6 Pourquoi un tel titre ? Pour profiter de la vague d’enthousiasme qu’a suscitée l’adaptation de Simetierre (1989) ? Peut-être, mais ne vous y trompez pas, le cimetière, c’est pour la décoration !
7 Interview with Darrell Ewing and Dennis Myers (1986), in Feast of fear, op.cit., p. 109 : » it’s flavorless ; it’s like cafeteria mashed potatoes. There are things that happen in terms of special effects in that movie that make no sense to me whatsoever. «
8 Dans le Film de Fraser Heston, une scène montre le père Brigham sur le point d’être écrasé par le clocher de l’église… son peu envieux auquel succombe le père Brennan dans La Malédiction, transpercé par la flèche de l’édifice religieux. Même cadrage et même contre-plongée dans les deux films.
9 Propos recueillis et traduits par Marc Toullec dans Mad Movies, n°80, novembre 1992, p.28.
10 Propos recueillis et traduits par Marc Toullec dans Mad Movies, n°80, novembre 1992, p.28. Lire à ce propos Irène Bessière, » Autour de Stephen King : Fantastique, littérature et cinéma « , p.323-26. in Dramaxes. De la fìction policière, fantastique et d’aventures, dirigé par Denis Mellier et Luxc Ruiz, Fontenay/Saint-Cloud : E.N.S. Éditions. 1995