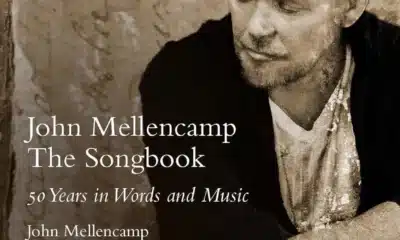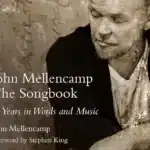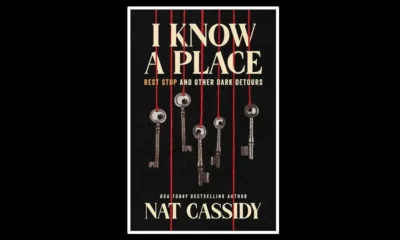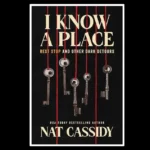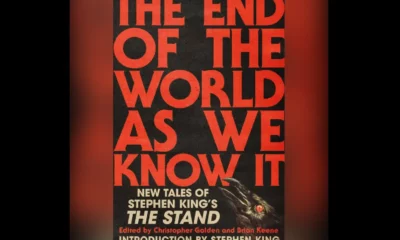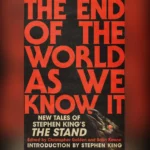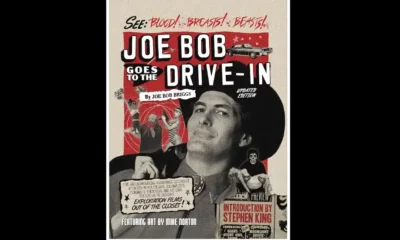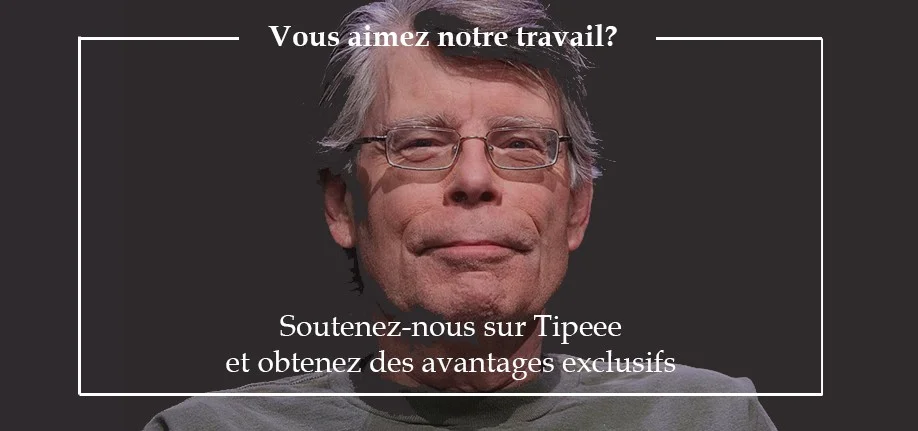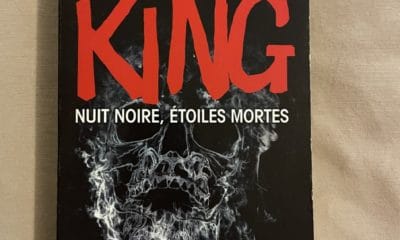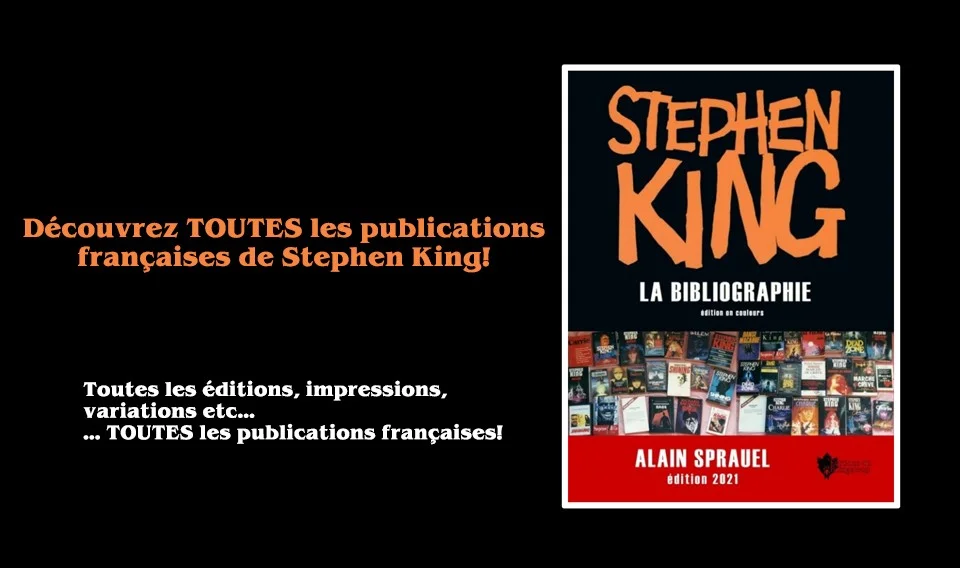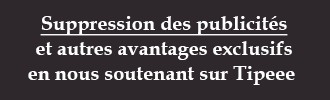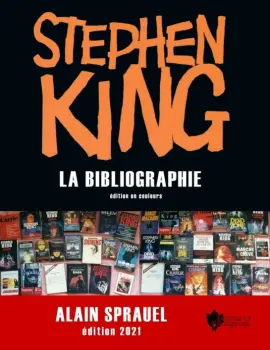Dans un nouvel essai publié sur le site de Lithub, Stephen King revient sur les adaptations de son oeuvre.

A l’occasion de l’arrivée de la série « CA : Bienvenue à Derry », qui débute ce weekend (dimanche aux USA / lundi en France), en streaming, exclusivement sur HBO Max, le site Literary Hub partage un essai de Stephen King dans lequel il revient sur les adaptations de son oeuvre.
« Je vois les films et les livres comme des pommes et des oranges. Ce sont deux fruits, mais leur goût est remarquablement différent »
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous aimez notre travail, n’hésitez pas à liker/commenter/partager en masse sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez également nous supporter (et obtenir des avantages exclusifs) via notre compte Tipeee, pour le prix d’un petit café 😉
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En 2025, quatre de mes romans et deux nouvelles ont été adaptés au cinéma ou en séries télévisées. Je trouve cela déroutant et franchement étrange. Et aussi, c’est vrai, plutôt cool.
Cela s’explique en partie par le succès fulgurant de l’adaptation en films de mon roman, « Ça » par Andy Muschietti. Ce succès doit beaucoup à la performance de Bill Skarsgard dans le rôle du clown tueur. Grippe-sou a désormais rejoint Freddy, Jason et Michael Myers au panthéon des croquemitaines modernes. Quoi que fasse ce talentueux acteur, Skarsgard portera l’héritage (ainsi que le fardeau) de ce clown pour le reste de sa carrière.
Le budget de « Ça » était modeste : 30 millions de dollars. New Line (qui avait hérité du projet de Warner), s’attendait à des résultats tout aussi modestes, semblait évident puisqu’ils avaient fait appel à Muschietti dont le film précédent (« Mama », co-écrit avec sa soeur Barbara Muschietti) avait un budget de 15 millions. Aussi, New Line avait planifié la sortie pour après Labor Day (le premier lundi de septembre, un jour de fête nationale aux USA, ndlr) qui était une période généralement considérée comme peu propices dans les sorties, après les autres périodes similaires de février et mars.
Nous avons tous été exposés à des histoires au cinéma ou à la télévision avant même de savoir lire, et les premières impressions sont des impressions durables.
Ce sur quoi personne n’avait compté, et moi notamment, c’est qu’une génération entière, aujourd’hui en âge d’aller voir un film interdit aux moins de 18 ans, avait été traumatisée, enfant, par Tim Curry, qui incarnait Pennywise le Clown dans un téléfilm d’ABC (avec alors un maigre budget de 12 millions de dollars). Ce téléfilm, réalisé par Tommy Lee Wallace, avait été un succès tant en audience que critique, contournant d’une certaine manière la règle tacite de la censure télévisuelle qui stipulait : « Tu ne mettras pas tes personnages de moins de 14 ans en danger de mort ». Tim Curry était excellent dans le rôle de Grippe-sou, donnant aux enfants américains (et peut-être du reste du monde) des raisons de craindre l’offrande d’un ballon rouge et la promesse : « Nous flottons tous en bas « .
Ces enfants, devenus adultes, étaient impatients de revivre la terreur qu’ils avaient ressentie enfant. La nostalgie, aussi étrange qu’elle puisse paraitre, reste de la nostalgie. Nombre d’entre eux ont amené leurs propres enfants se faire terroriser par le nouveau Grippe-sou, un personnage initialement conçu dans un parc de Boulder, au Colorado, alors que je traversais un pont en bois en songeant aux trolls.
Le succès de « Ça », avec son clown effrayant, a sans aucun doute fait espérer aux scénaristes, réalisateurs et producteurs un jackpot similaire. Ils en ont au moins obtenu un avec les films « Terrifier », et son clown Art (interprété par David Howard Thornton). Il y a aussi le simple fait que les films d’horreur connaissent un succès phénoménal, surtout en période d’incertitudes. Les gens aiment se faire peur avant d’affronter l’horreur réelle des prix des supermarchés.
Le succès de Ça n’explique pas entièrement toutes les autres adaptations de films et de séries télévisées basées sur mon travail. Il y en a eu plus de 100, si l’on inclut des séries comme « Haven » et « The Dead Zone ». Il y a également eu trois merveilleuses séries télévisées basées sur les livres de Bill Hodges : « Mr Mercedes », « Carnets noirs » et « Fin de ronde », qui ont été diffusées sur la plateforme de streaming Audience, appartenant alors à AT&T. Bill Hodges était interprété par Brendan Gleeson et Holly Gibney par Justine Lupe.
Jack Bender, un vétéran de « Lost » et le créateur de la série « The Institute », sortie cet été (l’une des meilleures adaptations cinématographiques de mon travail, avec une narration à la fois crue et simple), a créé la trilogie Mercedes et réalisé les épisodes clés. David Kelly et Dennis Lehane ont écrit pour la série. Gleeson et Lupe étaient formidables, les scénarios étaient intelligents, la mise en scène excellente, mais le public n’est jamais venu. S’il s’agissait d’un concert de rock prévu dans un stade, les trois saisons de la série avec Hodges ont fini par jouer de la guitare acoustique dans un café. (Métaphore de ce qu’il disait juste avant, que la série devait être un gros événement, un grand concert, qui n’a été au final été qu’un petit concert intime, ndlr). (Elles sont maintenant disponibles sur Peacock)
Bill Thompson, mon premier éditeur, a dit un jour : « Steve King a un projecteur dans la tête ». C’est vrai en partie, mais on peut en dire autant de presque tous les auteurs de fiction actuels. Nous avons tous été exposés à des histoires sur les écrans de cinéma ou à la télévision avant de savoir lire, et les premières impressions sont des impressions durables. On constate une admirable dynamique narrative chez des auteurs comme Thomas Hardy, Charles Dickens, Jane Austen et Joseph Conrad, qui ont travaillé sans cinéma et qui, de ce fait, n’ont pas la même lucidité. Les histoires sont là, mais la qualité imagée des romans écrits aux XXe et XXIe siècles est absente.
Le cinéma est un sport d’équipe. Quand j’écris des histoires, je suis seul avec mon clavier face au monde.
Chaque écrivain évolue par à-coups; il existe remarquablement peu de cas d’une ascension lente et régulière vers ce que le musicien Al Kooper a appelé un jour « ce saut quantique vers le goût ». À propos de Bob Dylan, la chanteuse-poète Patti Smith a dit un jour : « Ce n’était qu’un chanteur folk comme les autres, mais à son retour [en bus du Minnesota], il était devenu Bob Dylan »
À mon arrivée à l’université, je n’étais qu’un écrivain d’horreur en herbe, mais l’une de ces poussées d’adrénaline s’est produite lors d’un séminaire de poésie, où j’ai été influencé par des poètes comme William Carlos Williams, dont le célèbre dicton était « Pas d’idées, mais dans les choses ». Je n’ai jamais été un grand poète (même si j’ai fait de mon mieux), mais le conseil de Williams m’a touché. Ainsi, les personnages de mes histoires n’ouvrent jamais une armoire à pharmacie pour voir de l’aspirine générique, mais de l’Excedrin ou de l’Anacin. Ils n’ouvrent jamais le réfrigérateur pour prendre une bière, mais plutôt une Bud ou une PBR.
Je pense que c’est cette clarté qui a séduit des réalisateurs aussi variés que Brian De Palma, Stanley Kubrick, Frank Darabont, Jack Bender et Mike Flanagan. Ils voient ce que j’ai écrit et veulent le porter à l’écran. Quand je discute avec de jeunes auteurs, je leur dis que lorsqu’ils visualisent une scène, le plus important est de distinguer ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Si on fait son travail, tout ce qui se passe entre les deux se règle tout seul.
Une autre chose m’a rendu assez adaptable : je m’immisce rarement dans le processus de réalisation d’un film. Je vois le cinéma et les livres comme des pommes et des oranges. Ce sont deux fruits, mais le goût est remarquablement différent.
Un jeune journaliste s’est un jour plaint à James M. Cain de la façon dont les films avaient ruiné ses livres. Cain a ri et a fait un geste vers l’étagère derrière lui. « Non, ce n’est pas le cas », a-t-il dit. « Ils sont tous là-haut. ». (Comprendre, que les livres continuent d’exister, ndlr)
J’envoie mes livres au cinéma comme des parents envoient leurs enfants à l’université, en espérant qu’ils réussissent et qu’ils ne tombent pas dans les pièges (drogue, alcool, relations toxiques…). Je donne des conseils quand on me les demande. Sinon, je me tais et j’espère que tout ira pour le mieux, sachant que mes livres – bons, mauvais, indifférents – sont toujours tous là-haut sur l’étagère. J’aime ça. Le cinéma est un sport d’équipe. Quand j’écris des histoires, je suis seul avec mon clavier face au monde.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous aimez notre travail, n’hésitez pas à liker/commenter/partager en masse sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez également nous supporter (et obtenir des avantages exclusifs) via notre compte Tipeee, pour le prix d’un petit café 😉
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….