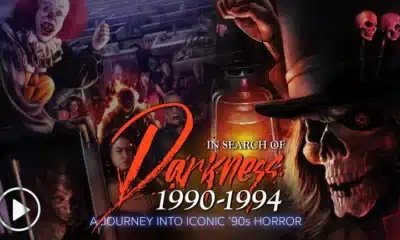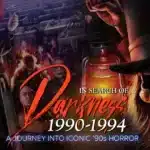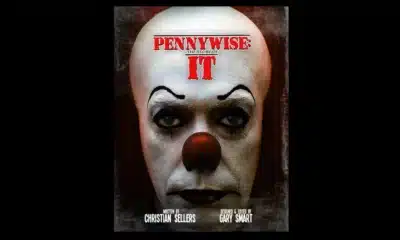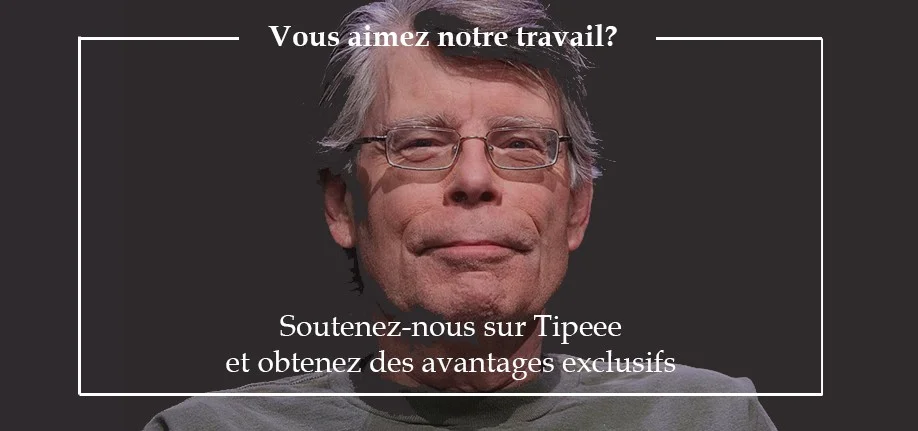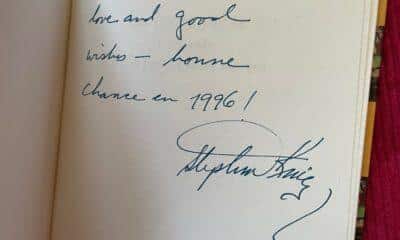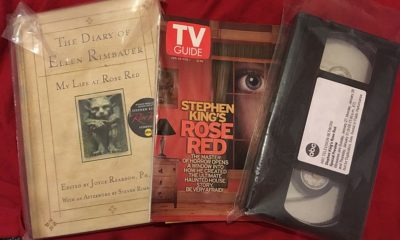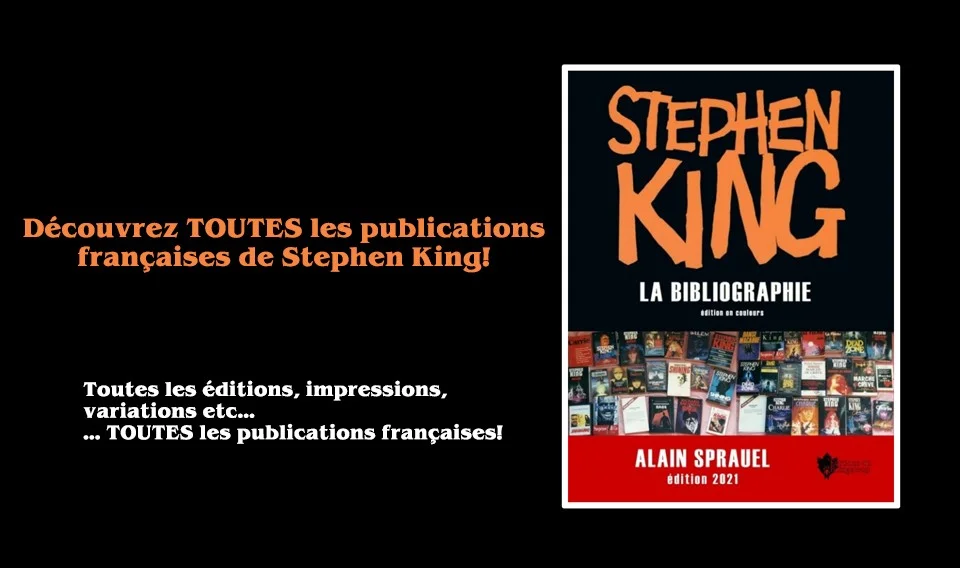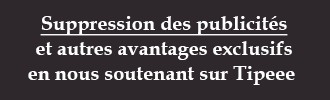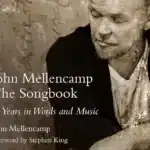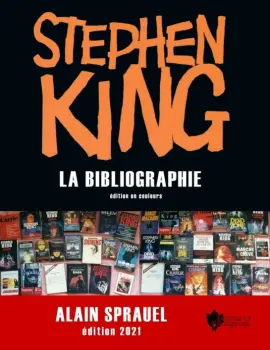SHINING IN THE DARK

Titre original : Who’s Afraid of Stephen KING
Année : 1999
Documentaire, réalisé par David Stewart
Durée : 50min
Avec
Kathy Bathes
Frank Darabont
Mick Garris
Tom Hanks
Burt Hatlen
Stephen King
Rob Reiner
Peter Straub
Chuck Verrill
Sujet :
Documentaire sur la vie de Stephen KING, entrecoupé d’extraits de films, d’interviews d’amis et de proches, d’anecdotes…
Cet excellent documentaire n’existe malheureusement ni en VHS, ni en DVD… mais certaines personnes l’ont mis en ligne sur Youtube 😉
Retranscription et traduction du documentaire « Shining in the Dark »
Il y a quelques temps, une émission exceptionnelle passait sur la chaîne de télévision ARTE. Cela s’intitulait STEPHEN KING : SHINING IN THE DARK et on y découvrait de nombreuses interviews très intéressantes et enrichissantes. Pour ceux et celles qui nous pas eu la chance de voir cette émission, nous vous proposons aujourd’hui la première partie de la retranscription complète de SHINING IN THE DARK… Bonne lecture.
Lou Van Hille
Le 03/11/00
Steve est une sorte d’agneau géant, mais du genre qui se penche vers vous à table et vous murmure quelque chose qui vous fera dormir toutes lumières allumées pendant un bon nombre de mois.
CHUCK VERRILL : Il est parti de rien et il est devenu un de nos écrivains les plus prospères.
KATHY BATES : C’est un acteur quand il écrit. Il écrit pour les acteurs. C’est à Stephen King que je dois ma carrière au cinéma.
STEPHEN KING : J’aime tenir entièrement le lecteur entre mes griffes et si je m’écoutais jusqu’au bout, je mettrais les gens dans un état où arrivés à la fin du chapitre 9, ils diraient : « je crois que ce soir, je laisserai allumé ».
CHUCK VERRILL : On le définit souvent comme un romancier de l’horreur. Mais pas du tout. C’est la terreur qui imprègne son œuvre. Elle est, en quelques sortes, le moteur de la réaction du lecteur mais son oeuvre a une portée beaucoup plus grande que ce que pensent les gens.
STEPHEN KING : Est-ce que j’aime faire peur ? Bien sur ! Est-ce que j’aime l’idée qu’on me considère et parfois me stigmatise comme auteur de romans d’horreur ? Non !
COMMENTATRICE : Quand Stephen King a eu 50 ans, l’auteur américain le plus vendu n’a pas fêté son anniversaire dans une librairie entouré de confrères écrivains mais sur un plateau de cinéma au milieu des acteurs et notamment de Tom Hanks le gardien chef de LA LIGNE VERTE, une adaptation de son roman THE GREEN MILE.
STEPHEN KING : Je sais ce dont je rêve. Je ne dis pas trop que j’aimerais que ce film rafle tous les oscars car ça raterait, mais si je le disais fort, ça ressemblerait à ça.
TOM HANKS : Quand on entend le nom de Stephen King, on se dit qu’on va avoir droit au genre d’histoires d’horreur qui lui sont propres. Mais là, ce n’est pas le cas. C’est plus un mystère qu’autre chose, qui s’apparente assez à SHAWSHANK REDEMPTION, avec d’autres éléments qui en font une histoire extrêmement dense, tellement d’ailleurs que nous sommes tous en train de devenir fous. Car travailler sur ce film c’est comme être dans une prison à sécurité allégée. On a le droit d’arpenter les couloirs mais pas de sortir. On va au même endroit tous les jours, c’est très noir, très crade, c’est un climat, mais pas des plus agréables.
COMMENTATRICE : LA LIGNE VERTE est l’histoire d’une série de miracles surgissant dans le couloir de la mort d’un pénitencier.
FRANK DARABONT : C’est un romancier tout à fait classique. Et quand je le compare à Mark Twain, je ne plaisante pas du tout. C’est un classique dans sa manière de nouer une intrigue, ce qui me force à mon tour à revenir à une façon plus traditionnelle de tourner.
TOM HANKS : Il arrive à créer des personnages qui sont imparfaits mais bons et d’autres qui sont imparfaits mais méchants. Ou bien des personnages positifs mais aussi méchants. Les deux en même temps. Ce n’est pas les gentils bons d’un côtés et les affreux méchants de l’autre. On arrive toujours à comprendre ce qui pousse les méchants.
COMMENTATRICE : Depuis 25 ans, Stephen King est le romancier le plus apprécié des cinéastes d’Hollywood. Presque tous ses livres ont été adaptés pour le cinéma ou la télévision. Il s’est fait un nom dès les années 70 avec des classiques de l’horreur comme CARRIE ou SHINING. Mais tout ce qu’il écrit évoque aussi un traumatisme émotionnel profond et se passe dans un monde familier, voire banal.
MICK GARRIS : Comme Stephen Spielberg l’a fait dans le monde du rêve, lui s’est ancré dans le monde du réel. Il y a des références à des noms de marques, à des gens qui mangent au McDo., qui font leurs courses chez K-Mark, qui font tout ce qu’on fait dans la vie réelle et qu’on n’a pas l’habitude de voir à la télévision ou au cinéma.
FRANK DARABONT : Ils ont sorti l’horreur des vieux châteaux en ruines de Transylvanie pour l’installer à côté de chez vous.
COMMENTATRICE : Presque toutes les histoires de Stephen King ont pour cadre le Maine, une région faiblement peuplée proche de la frontière Canadienne. En apparence, une des plus belles et des plus sereines d’Amérique, mais qu’il dépeint comme l’un des états les plus épouvantables et sanglants de l’Union.
PETER STRAUB : Le Maine est un état très attardé, très pauvre. C’est l’un des derniers endroits d’Amérique qui reste une région. Les gens qui y vivent ont un accent très caractéristique au point que les étrangers ont parfois du mal à les comprendre. La plupart sont habillés de la même façon ; ils sont à moitié édentés, portent une casquette vissée sur la tête, conduisent des Pick-ups. Ils sont restés rugueux ; ils n’ont pas ce côté très mélangé qui caractérise les populations suburbaines d’aujourd’hui.
CHUCK VERRILL : La vraie violence aux États-Unis est le fait que de gens qui se sentent écartés de la réussite ou de la popularité et Stephen King a parfaitement compris ça parce qu’il est resté dans le Maine.
COMMENTATRICE : Stephen King a passé presque toute sa vie dans le Maine. Il a été élevé par sa mère dans la toute petite bourgade de Durham ; tellement minuscule qu’elle n’a même pas une grand rue. Son père a disparu quand il était encore très jeune.
STEPHEN KING : J’avais deux ans quand il a foutu le camps. Ensuite, on a beaucoup bougé et je pense qu’elle essayait de le retrouver pour qu’il paie une pension. Elle est morte du cancer et vers la fin, avec tous ces médicaments, toutes ces drogues, elle était pratiquement tout le temps dans les vapes. Et quand j’allais la voir vers la fin, elle me disait : « Tu sais Stephen, pendant moment avant la guerre, ton père a été vendeur d’aspirateurs » et elle balançait ça comme font souvent les gens quand ils sont shootés. Elle disait : « Ton père était le seul vendeur qu’Electrolux ait jamais eu capable de vendre un aspirateur à une veuve à deux heures du matin ».
STEPHEN KING : [Montrant une bâtisse] C’est là que je suis allé à l’école. On est arrivé ici, j’avais huit ans et j’étais en CE2. J’ai fait ici mon CM1, mon CM2 et ma 6ème. J’étais le plus brillant tout simplement parce qu’on n’était que trois. Il y avait un bègue, un attardé mental et moi.
STEPHEN KING : [Montrant RUNAROUND POND ROAD] Ca a moins changé que je ne l’imaginait. Cette route était un chemin de terre quand j’étais gosse, mais il y a toujours la maison des Harrington par là et celle de ma tante par ici, celle en brique [montrant une grande maison un peu plus loin]. On allait ramasser des myrtilles dans ce champs, avant qu’ils y plantent des haricots. Et c’est là-bas qu’on aller se doucher ou se baigner car on n’avait pas non plus l’eau courante. Il fallait y aller à travers champs.
STEPHEN KING : [Montrant un point d’eau] Et on venait pêcher ici, mais personne n’y nageait. Un jour de grande chaleur, on sait dit « Après tout, zut, on se baigne ». On était six ou sept. On avait nos tubas et tout l’équipement et on a barboté. Et mon copain David Hannah a fait le poirier. Ses pieds sortaient de l’eau et il est ressorti couvert de trucs noirs. Il en avait plein les jambes. Il était roux et avait des petites jambes roses et potelées. J’ai regardé et j’ai dit « Putain, j’y crois pas, il faut se tirer d’ici ». On est tous sortis de l’eau. On en était couvert. On se les ait mutuellement enlevées du mieux qu’on pouvait. On pleuraient tous. Et mon cousin Robbie D. geignait « Faîtes gaffe, si vous les tirez trop fort, leur bouche risque de rester accrochée. Ca peut s’infecter » ; et le reste à l’avenant. Donc, on les arrache. Certaines se décrochent et tombent par terre et tout d’un coup, un des gosses dit « Oh merde, regarde… ». Il tient son maillot de bain comme ça [Mimant quelqu’un qui écarte son maillot de bain pour regarder à l’intérieur], il regarde dedans et il fait « Steve, il faut que tu m’aides, il faut que tu les décroches ». Et moi : « Si tu crois que je vais mettre les mains dans ton maillot, pas question ». Il plonge donc lui même la main. Il lâche la bestiole qui était énorme. Elle avait réussi à rentrer dans son maillot et à s’accrocher à ses testicules. Il fait juste « Haaa… ». Ses yeux se retournent et il part à la renverse dans les pommes. Quelques années plus tard, alors que je travaillais sur une histoire intitulée BODY, dont a été tiré le film STAND BY ME. J’ai repensé à cet incident et j’ai mis dedans tout ce dont je me rappelais. Je n’avais pas vraiment le projet d’écrire sur mon passé et sur mon enfance, simplement sur une bande de gosses qui marchent le long d’une voix de chemin de fer à la recherche d’un cadavre. Et j’ai découvert que je tenais quelque chose à quoi j’allais pouvoir accrocher un tas de choses de mon enfance ; des trucs rasoirs que, sinon, personne n’a envie d’entendre.
PETER STRAUB : Si vous regardez ses descriptions de l’enfance, c’est pour lui une période de bataille rangée où le seul réconfort vient des autres enfants qui se lient d’amitié avec vous et de la pratique de l’imagination. Des millions de gosses ont des enfances plus que terribles mais très peu deviennent pour autant de bons écrivains. Il n’y a pas de liens de cause à effet. Simplement, chez l’écrivain en herbe, l’enfance qu’il a vécue rejaillit sur ce que sera sa prose.
CHUCK VERRILL : L’essentiel de son œuvre replonge ses racines dans un traumatisme d’enfant, un viol d’enfant. Même si l’intrigue met en scène un adulte, à un moment du livre, on découvrira que le personnage est définit par un événement de son enfance.
STEPHEN KING : [Montrant une autre bâtisse] C’était la maison de Harry Davis, un vieux fermier à qui on taillait la haie. Un jour il passe, on marchait avec mon copain Chris. Davis était un petit maigrichon avec des lunettes à montures d’écailles et il nous dit « Où vous allez les gars ? Montez donc ». « Ben, on se fait juste une balade ». « Allez, montez, y a rien dans la malle à part une pelletée de cadavres ». Alors, on a fait « On n’a pas trop envie ». Quelques jours plus tard, il s’est retrouvé à l’hosto. Dépression nerveuse. Et personne n’avait rien dit. C’est comme ça à la campagne. Il avait un fils, Tommy Davis, qui devait avoir dans les neuf ans, qui épluchait la rubrique nécrologique et biffait les noms dans l’annuaire téléphonique. C’est vrai !
STEPHEN KING : [Montrant une autre maison] C’est là que j’ai grandi. C’était notre maison. Elle a pas mal changé. Ici c’était ma chambre. J’y ai écrit deux livres qui ont été publiés par la suite, dont l’un s’appelle qui RAGE n’est plus édité depuis car il parle d’un gosse qui y part à l’école avec un revolver et se met à tirer sur ses camarades. J’ai écrit beaucoup de livres sur les ados poussés à la violence mais RAGE, c’est presque un mode d’emploi. « Voilà comment il faut faire ». Et quand ça a commencé à arriver, notamment la fusillade de Peduka au Kansas où trois gosses d’un groupe de prière on été tués. Le môme qui a fait ça avait le livre dans son casier. Là, j’ai dit : « Ca suffit, ce livre ne sera plus vendu ». Non pas qu’ils ne trouveront pas autre chose. Je ne crois pas qu’un enfant ait jamais été poussé à la violence par un disque de Metallica ou un CD de Marylin Manson ou un roman de Stephen King mais je pense que ça peut potentialiser. Le vrai problème de la violence en Amérique à la différence de la violence en Angleterre, en Écosse ou autre, c’est tout simplement la disponibilité des armes à feu. C’est là qu’est le problème. Il y a tout une culture de la violence dans ce pays et ce n’est certainement pas moi qui vais nier en faire partie, mais je ne suis que l’enfant de ma culture.
(Suite et fin dans le RAG # 25)
COMMENTATRICE : Cette fascination de Stephen King pour la violence infantile a commencé très tôt. A 10 ans à peine, il tenait déjà un album avec dedans le portrait du plus célèbre tueur en série des années 50 : Charlie Starkweather, auteur d’une balade meurtrière dans le Nebraska et le Wyoming en compagnie de sa petite amie de 14 ans, Caril Ann Fugate. Bilan : 11 tués dont le père et la mère de celle-ci.
[Extrait d’un reportage d’époque sur Starkweather]
STEPHEN KING : Il a été le premier annonciateur d’une air nouvelle dont le meurtre en série est devenu en quelques sortes la marque dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis. Et comme c’est le cas dans bien des domaines en matière de meurtres en série, l’Amérique caracole en tête. Alors que dans les années 50, ce genre de choses n’arrivait pas ou en tout cas pas très souvent. Je tenais un album pour savoir quoi chercher et quoi éviter. Il y avait deux zéros absolus sur le visage de ce gosse. J’y voyais quelque chose de profondément inhumain. Pas inhumain au sens de démoniaque, mais comme le double zéro d’une roulette. Rien, ni bien, ni mal, le néant. Quelque part entre la Voie Lactée et la galaxie d’à côté. Même toutes les lumières allumées, personne ne le voyait. Et à 10 ans, je me disais que je devais m’imprégner, pas seulement de son visage, mais de tout ce qu’il était pour me rappeler que je pouvais éviter ce genre de gens. Il y a sans doute quelque part en nous un circuit imprimé. Même à 10 ans, on est potentiellement celui qu’on sera. Oui, je suppose qu’il me parlait en tant que sujet de roman. Une voix en moi me soufflait : « C’est lui ». « C’est sur ce genre de fléau que tu vas passer ta vie à écrire ». « C’est ça le point de départ ».
COMMENTATRICE : Mais si Starkweather est l’étincelle qui enflamme sa fascination pour l’horreur, l’école ne va faire qu’attiser le brasier.
STEPHEN KING : Je détestais l’école. Tous ceux qui se rappellent avec plaisir leurs années de 14 à 18 ans, je ne leur fais pas confiance. Vous avez aimé votre adolescence ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Quand je me remémore ces années, je ne voudrais vraiment pas avoir à les revivre. J’avais toujours l’impression de ne pas être habillé comme il fallait, d’avoir trop de boutons sur la figure, alors que j’avais très peu d’acné. J’ai eu beaucoup de chance sur ce point. Quand j’y repense, avec ma perspective d’homme mûr, j’ai le sentiment de ne pas avoir été plus maltraité que les autres et bien mieux que beaucoup. Et pourtant, à l’époque, quand on le vit, c’est pour la plupart d’entre nous un cauchemar. L’adolescence est une période difficile.
PRUDENCE GRANT : C’était un bon petit. Je ne me souviens d’aucun problème disciplinaire mais sur le plan de l’éveil et de la débrouillardise, c’était un petit paysan. Il était souvent en but aux moqueries et tyrannisé par des camarades plus âgés. Ils le trouvaient pas comme les autres.
DEAN HALL : Il était incontestablement excentrique et bizarre. Il se promenait tout le temps en pantoufles quelque soit le temps. Parfois, par pauvreté mais quelques soit la raison, il ne mettait que cela et il les laissait traîner. Quand il venait chez nous, il les oubliait n’importe où et parfois, il fallait lui dire : « Hey, tes pantoufles ! ».
DEAN HALL : Il lisait beaucoup. Des livres d’horreur, des BD, des histoires de mystères et il se baladait toujours avec un bouquin dans la poche arrière de son Jean. Il était toujours limite excentrique mais sympa. Il était Steve. Cool.
COMMENTATRICE : Aspirant à devenir écrivain, il étudie l’anglais à l’Université du Maine. Mais on y enseigne pas comment devenir romancier.
BURTON HATLEN : A certains égards, il n’avait pas besoin d’apprendre à écrire de la fiction. Il savait d’instinct comment planter un décor, créer des personnages intéressants. Et entretenir une dynamique narrative qui vous entraînait. C’est un véritable écrivain avec tout le savoir faire d’un magicien de la culture Pop-Art. Et il combine ces deux qualités de façon, à mon sens, unique. Je ne connais personnes d’autres dans la culture américaine qui dans l’époque récente ait réussi cela.
COMMENTATRICE : C’est à l’Université du Maine que Stephen King rencontre et épouse Tabitha. ils ont très vite un enfant et toutes les peines du monde à joindre les deux bouts.
MICHAEL ALPERT : Steve était très pauvre. Avec Tabby, ils ont vécu dans une caravane qu’ils avaient toutes les peines du monde à payer. Steve conduisait un camion de blanchisseur pour se faire un peu d’argent. Il a fallu qu’il étudie à la force du poignet. Financièrement, ils s’en sortaient à peine. Tabby et lui se sont vraiment faits tout seuls.
COMMENTATRICE : C’est au milieu de ces difficultés, dans une caravane, pendant que sa femme travaille la nuit dans un snack, qu’il écrit son premier roman publié, CARRIE, qui faillit, d’ailleurs, ne jamais voir la lumière du jour.
STEPHEN KING : Je l’ai jeté et elle est allée le repêcher dans la corbeille à papier. Je me souviens parfaitement de cette nuit. J’étais dans le baignoire, fumant un cigarette. Ca se faisait encore, c’était dans les années 70. C’était une configuration superbe pour une caravane. Il y avait la baignoire et juste à côté, la cuvette des W-C. Ce qui fait qu’on pouvait tapoter sa cendre dans la cuvette tout en prenant un bain et en buvant une bière. C’était le confort absolu. Il ne manquait plus que le transistor pour avoir aussi le Base-ball. Elle est rentrée, a coupé la radio, à abaissé le couvercle des toilettes et m’a dit : « Faut qu’tu continues ça ! »
COMMENTATRICE : CARRIE, c’est l’histoire d’une lycéenne rejetée par les autres qui utilise ses pouvoirs surnaturels pour se venger des camarades qui la tyrannisent.
STEPHEN KING : C’est un mélange de deux filles réelles. La première a essayé deux ou trois fois de s’affranchir de ce rôle de vilain petit canard, de perpétuel mouton noir. Et chacune de ses tentatives pour changer d’aspect, être plus vive, ou mieux s’entendre avec les autres était saluée par un retour de flamme encore plus sauvage de la part des autres. Surtout des autres filles. Toutes deux sont mortes. Aucune n’a atteint la trentaine. L’une d’elles s’est mariée et a eu des enfants. Et puis, d’après ce qu’on m’a raconté, elle a été victime de la dépression post-natale et s’est tuée. Le plus souvent les femmes se suicident aux médicaments. Mais elle, pas. Quelqu’un m’a dit : »Elle s’est tuée comme un homme, avec un fusil ». L’autre est morte d’épilepsie alors qu’elle avait enfin réussi à se libérer d’une mère abusive.
COMMENTATRICE : Sauvé de la poubelle, CARRIE devient son premier Best-Seller et rapporte à son auteur fauché un à-valoir de 200,000 dollars. Stephen King peut maintenant se permettre de devenir écrivain à plein temps et continuer à puiser son inspiration dans les petites choses effrayantes de la vie quotidienne.
STEPHEN KING : Je suis rentré un jour et Joey, mon aîné, qui avait trois ou quatre ans à l’époque avait entièrement crayonné tout le manuscrit sur lequel je travaillais. Il y avait des tas de choses gentilles, du genre « salut papa », des cartes, des soleils et des très grands personnages comme les gosses aiment les faire aux crayons de couleurs, avec des longues jambes comme papa, et je me suis dit en moi même : « Le petit salopard ! J’le tuerais si je m’écoutais. Regarde moi ça ! » et ça a été le point de départ de SHINING.
STEPHEN KING : SHINING, c’est l’histoire d’un père qui a littéralement envie de bouffer son gosse. Tout parent connaît des moments de ce genre. Pour moi, il y a dans ce livre un côté optimiste, même dans les pages les plus sombres, car si un père s’emporte contre son gosse, ça veut dire qu’il est au moins là. Alors que pour moi, il y avait un vide, ni bon, ni méchant, simplement le néant.
MICK GARRIS : Steve a été blessé par le film de Kubrik. Le thème de son livre était celui de l’alcoolisme, du sens de la responsabilité vis à vis de sa famille et de l’incapacité à y faire face. Celui d’une chaudière sous un hôtel qui va exploser et le détruire. Ce qui est aussi un symbole très puissant pour le personnage de Jack Torrance. Et ce sont ces thèmes que Kubrik a choisi d’ignorer.
FRANK DARABONT : C’est une histoire qui venait de là, du plus profond de son cœur. Je ne crois pas que Kubrik ait jamais réalisé avec son cœur. Ca venait toujours de là [Montrant sa tête]. Je n’ai jamais vu un Kubrik qui vienne de là [Montrant son cœur]. Quand vous puisez ici pour le mettre là [faisant un geste allant du cœur à la tête], ça ne peut pas marcher, c’est simple.
STEPHEN KING : Il semble qu’il ignorait tout de ce genre. De sorte que quand les gens ont le sentiment que Nicholson est fou dès le départ, on perd une part du tragique, car pour moi, l’essence du livre, c’est qu’on part d’un homme très bien et on le voit poussé a son point de rupture par cet endroit hanté. Si vous pensez qu’il s’agit d’un hôtel hanté, très bien. Pourquoi pas ! Si vous pensez qu’il s’agit d’un endroit hanté en lui même, très bien aussi. Et si vous voulez y voir une allégorie, allez-y ! Je ne choisis pas nécessairement l’un ou l’autre, mais j’ai très longtemps pensé que les fantômes étaient en fait des secrets enfouis, de la mauvaise conscience et des problèmes psychologiques non traités. Autant de choses que Jack Torrance démontre dans SHINING.
COMMENTATRICE : Les Best-Sellers se succèdent au rythme de plus d’un part an et Stephen King devient rapidement l’écrivain le mieux payé du monde.
CHUCK VERRILL : Son succès a été immense. Sa carrière s’est développée à une époque où le marché de l’édition était en profonde mutation et ce au bénéfice des écrivains populaires. Tout à coup, un écrivain qui tirait à deux cent ou trois cent mille exemplaires pouvait se retrouver à huit cent mille, un million, un million quatre d’exemplaires. Tout simplement parce qu’on a commencé à vendre des livres dans les grandes surfaces, les supermarchés ou autres. On le trouvait dans des points de ventes où il n’avait jamais été jusque là.
MICHAEL ALPERT : Steve a effectivement créé une nouvelle catégorie d’écrivains qui n’existait pas. En tout cas, à l’époque moderne. Il faudrait remonter à Dickens et des gens comme ça pour trouver quelqu’un d’aussi populaire qui soit en même temps légitimé comme écrivain.
COMMENTATRICE : Stephen King devient donc l’écrivain le plus célèbre des États-Unis et sa fulgurante carrière lui inspire MISERY, l’un de ses plus terrifiants romans.
STEPHEN KING : MISERY, c’est le prix de la gloire.
COMMENTATRICE : MISERY raconte l’histoire d’un écrivain de romans d’amour, Paul Sheldon, rescapé d’un grave accident de la route et récupéré par Annie Wilkes, sa plus grande fan, jouée par Kathy Bates.
KATHY BATES : Je me souviens que je jouais dans une pièce à New York et j’habitais chez une copine d’Université. Il est arrivé avec le roman qu’il venait de finir. Il me l’a tendu en me disant : « Quand ils en feront un film, il faut que ce soit toi ».
COMMENTATRICE : Elle emprisonne l’écrivain dans sa maison et le force à ressuscité son personnage favori qu’il avait tué dans son dernier roman.
CHUCK VERRILL : Quand j’écrivais encore les jaquettes de ses livres, j’avais dit que c’était une lettre d’amour à ses fans. mais à la manière de Stephen King. Il en a une trouille bleue.
ROB REINER : MISERY est certes un livre d’horreur mais extrêmement réaliste du point de vue des personnages. Ca n’a rien à voir avec CARRIE où il se passe des choses surnaturelles. C’est basé sur quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Quelqu’un pourrait parfaitement être kidnappé et torturé par un fan dérangé. On peut lire ce genre d’histoire dans les journaux.
KATHY BATES : MISERY est surtout bon surtout grâce à Rob Reiner. Il a fait un boulot extraordinaire. Il voulait que ce soit très véridique et je me souviens qu’il a coupé une scène que j’ai très envie de jouer parce qu’il avait peur que le public éclate de rire et il ne voulait pas de rires à ce moment là. Lorsque le shérif vient à la maison, et qu’elle le tue en passant dessus avec la tondeuse à gazon et le déchiquette en petits morceaux, j’adorais ça. Et l’autre chose que j’aurais beaucoup aimé, c’est qu’on lui coupe le pied. Pour moi, passer du couteau au scalpel et à la hache, c’était la séquence grand guignol normal pour Annie Wilkes, alors que passer du scalpel au couteau puis à la masse, c’était un peu… Pour moi, ça collait pas trop. De même, la manière dont elle le cautérise avec un chalumeau, il y a là un tel sens de la simplicité, de la logique que je regrette que nous n’ayons pas pu reprendre cela dans le film. Cela aurait été très difficile à faire.
COMMENTATRICE : Durant la plus grande partie de sa carrière, l’art de Stephen King s’est inspiré de sa vie. Mais, à la suite de MISERY, c’est l’horreur de la vie qui se met soudain à imiter l’art, le jour où un fan dément fait irruption chez lui.
STEPHEN KING : Le type, manifestement fou, était debout dans la cuisine au milieu des débris de verre, une boîte à chaussures à la main. Ma femme lui a crié : « Qui êtes-vous ? Que faîtes-vous ici ? ». Elle était en robe de chambre, pieds nus. Le type a répondu : « C’est une bombe. Stephen King m’a volé mon roman CARRIE, mon roman SHINING, mon roman MISERY. Je vais le faire sauter et moi avec ». Tabby n’en a pas demandé plus. Elle s’est retournée et l’a jeté dehors. Puis, elle a traversé la rue et a appelé la police. Celle-ci est arrivée alors que le type s’était réfugié dans une pièce du haut. Il est sorti lorsque la police lui a ordonné de le faire et sa bombe, ou ce qu’il croyait en être une, c’était des gommes à papier, reliées par des trombones qu’il avait redressés et piqués dedans. Ce n’est qu’une des retombées. Aucune n’est agréable. Du culte de la célébrité, ce qui explique, entre autres, pourquoi je n’accepte que peu d’interviews de ce genre.
PETER STRAUB : Il est passé de la catégorie Écrivain Célèbre à celle de Personnalité Célèbre et c’est comme un star du cinéma. Quand ça arrive, il faut fermer les écoutilles et rehausser les murailles. Ca devient inconfortable car tout le monde vous demande des autographes. Sa vie privée en a pris un coup.
COMMENTATRICE : Mais le prix de la célébrité n’a pas été tel qu’il se trouve contraint de quitter le Maine. Il joue toujours, chaque semaine, dans l’équipe locale de Soft-Ball.
STEPHEN KING : Je reste car tout le monde me connaît. Je connais tout le monde et en tant qu’écrivain, je reste pour la même raison que celle pour laquelle William Faulkner est resté dans le Mississippi. Car il n’y a pas beaucoup d’endroits au monde où on se sent chez soit, qu’on connaisse vraiment et qu’on puisse décrire. Je pense que les gens sont pareils partout. L’amitié, ça reste important, de même que l’amour, la haine, la dissimulation, toutes les choses que les gens font pour cacher leurs secrets, la peur de l’inconnu. Toutes ces choses sont intéressantes et sont partout les mêmes quelque soit l’endroit où la culture. Mais on n’a pas beaucoup de temps. On ne dispose que de soixante ou soixante-dix ans pour apprendre à bien connaître un ou deux endroits. Or, le Maine est un endroit que je connais bien. Je sais comment on y parle, quels en sont les coutumes et fondamentalement, j’aime cet endroit. J’aime les gens. C’est chez moi.
KATHY BATES : Il vit une vraie vie et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles il est si prolifique. Il vit, il est dans la vie, dans le monde et ce qui me frappe chez l’écrivain, c’est son talent d’observateur de l’humanité. Tous ses personnages fantastiques qu’il crée son ancrés dans une réalité extrêmement riche.
STEPHEN KING : Je suis un écrivain, mais pas en second, en troisième ou en quatrième. Je suis d’abord un mari, ensuite un père. Et il y a eu une époque où j’aurais sans doute mis père avant mari, quand les enfants étaient petits. En troisième, je suis un homme de chez moi, de mon temps et de ma communauté. Et je dois être tout cela d’abord car pour être un écrivain, tout en découle.
COMMENTATRICE : En apparence, Stephen King semble vivre la parfaite vie d’écrivain mais il lui a fallu mener un combat titanesque contre les tourments et les horreurs que lui affligeaient quelques puissants démons personnels.
CHUCK VERRILL : Quand j’ai commencé à travailler avec lui, nous sommes allés dans un bar à New York et nous nous sommes assis. J’ai commandé un bière et Steve trois ! C’est un grand gaillard. Plus tout à fait autant que jadis mais… Et là, je me suis dit : »Voilà un type qui n’a pas l’intention de s’arrêter à la seconde ou à la troisième. Cette compulsion, elle se manifeste sans arrêt dans son œuvre et si une dépendance, y compris à l’alcool, est une compulsion, ce qui à mon avis est le cas, elle le tient. Ne serait-ce que parce qu’il a essayé de se libérer de cette étrave. C’est un alcoolique repenti, un toxico repenti. Mais aucun de ces problèmes n’a entravé son écriture aussi surprenant que cela paraisse. Par contre, cela a entravé sa vie.
STEPHEN KING : Je ne suis jamais tombé sur une boisson ou une drogue que je n’aime pas. Si je pouvais en prendre, j’en prenais. Je tenais formidablement bien l’alcool, formidablement bien les drogues, pourvu qu’elles soient speeds. Tout ce qui passait. Coke ou autre. Je prenais tout ce que je pouvais et je ne pouvais pas m’arrêter tant qu’il en restait. Même chose pour la bouteille. Je buvais genre un pack de six avant le dîner et à la fin de la nuit, j’avais vidé une caisse. La boisson était déjà grave. Et si vous y ajoutez la drogue, et j’en prenais de plus en plus tout en sachant que je me consumais, mais je n’arrivait pas à m’arrêter. Il y a mille et une façon de traiter ce genre de choses. Mais dans tous les cas, il fallait d’abord que j’accepte le fait que j’étais une personne entièrement sous dépendance. J’étais une vraie poubelle. Je prenais tout ce que je pouvais trouver. Peu importait. Sirop contre la toux, désinfectant, tout ce qui passait, lotion pour la bouche, after-shave, tout, les trucs avec lesquels on se masse le gencives. Du moment que c’était de l’alcool et que je pouvais ingurgiter, je le faisais. Il y avait des choses que j’aimais plus que d’autres. Mais, en fin de compte, le seul choix, c’est qu’on ne peut plus continuer.
COMMENTATRICE : Le livre qui marque le début de sa bataille contre la boisson, c’est DOLORES CLAIBORNE, sur un thème récurrent dans les romans de King : le meurtre d’un père alcoolique et tyrannique.
STEPHEN KING : Dans DOLORES CLAIBORNE, certaines réactions m’ont été inspirées par les choses que je sais, pour avoir été moi-même alcoolique, mais beaucoup de ce que vit Joe St-George dans ce livre est basé sur des histoires qu’on m’a racontées, ou des gens que j’ai observés, car Dieu merci, je n’ai jamais eu l’alcool méchant. J’vous aurais plu.
COMMENTATRICE : Stephen King a fait fortune en donnant des frissons à des millions de lecteurs. Pourtant, ses 40 millions de dollars de revenu annuel ne peuvent rien contre l’effroyable hantise de devenir prochainement aveugle.
STEPHEN KING : Je souffre d’une dégénérescence de la macula, mais qui n’est pas dans une phase active. C’est un amincissement de la rétine. La plupart du temps, c’est une maladie de la vieillesse. La mienne est liée à une myopie extrême, d’origine génétique. Ce qui se passe, c’est que la rétine finit par se déchirer et c’est comme une chaussure trouée. Il n’y a pas de remède à l’heure actuelle. Si vous me demandez ce que ça fait d’être aveugle, je vous dirai que je n’en sais rien. Je ne l’ai encore jamais été, Dieu merci. Mais ma vue n’est pas bonne. Je ne les mets [Parlant de ses lunettes] pas pendant l’interview parce qu’elles sont très déformantes. Je suis obligé de porter ces culs de bouteilles, mais je vois encore. Qui sait, sans écrire, je crois que je continuerai. Regardez Christopher Reeves. Il est tombé de cheval, s’est retrouvé paralysé de la tête aux pieds et il s’y est fait. Il a continué à vivre.
COMMENTATRICE : Même s’il devient aveugle, ça ne l’empêchera pas d’écrire. Et à mesure qu’il atteint la fin de l’âge mûr, il semble pouvoir enfin goûter au respect envers l’écrivain, qui lui a été si longtemps refusé.
STEPHEN KING : Ca fait 25 ans que je fais ce métier, 25 ans que j’écris des histoires. J’ai été taxé d’écrivaillon au début, en cours de route, j’en étais sans doute un, et c’est maintenant, où j’approche de la fin, qu’on m’accorde un certain respect.
PETER STRAUB : J’ai toujours eu le sentiment qu’il s’était rendu à lui même un très mauvais service en disant de son style qu’il était l’équivalent littéraire du Big Mac avec frites. Une phrase célèbre qu’on n’a cessé d’utiliser contre lui à longueur de critique, comme d’un bâton pour le frapper. Il n’aurait jamais dû dire ça. Ca devenait trop facile de le démolir. Mais, en Amérique en tous cas, cette hostilité à cessé.
CHUCK VERRILL : Il lit toutes les critiques de manière obsessionnelle et il est très attentif à ce qu’elles disent. Mais, fondamentalement, ce n’est pas ça qui compte véritablement pour lui, c’est sa réputation.
STEPHEN KING : Il y a un moment où je dis : « Que les critiques aillent se faire foutre, ils ne comptent pas ». Car, finalement, où on continuera à vous lire 50 ans après votre mort, ou pas ! Vous n’y pouvez rien. Vous ne pouvez rien au jugement de la critique. On ne s’assoit pas pour écrire un Best-Seller ou l’éloge d’un livre comme Moby Dick.
ALLER A :