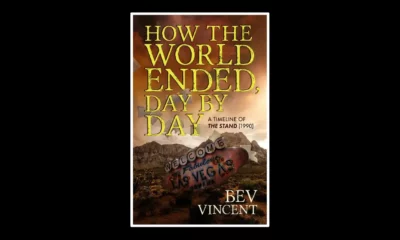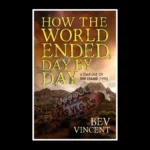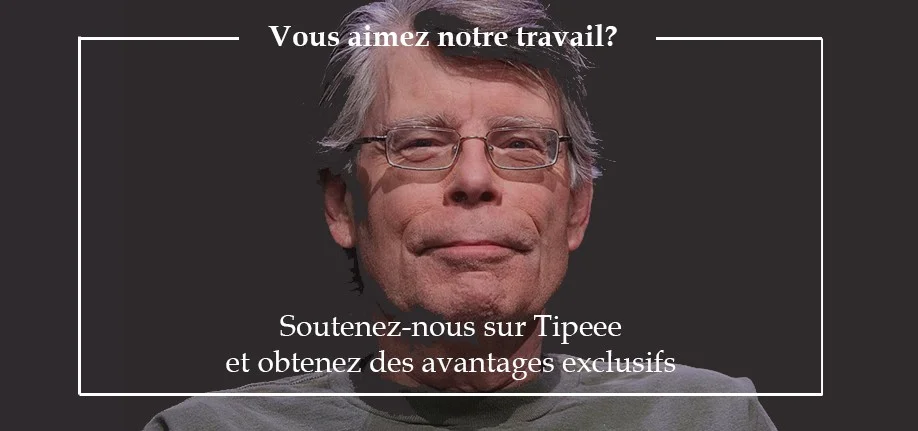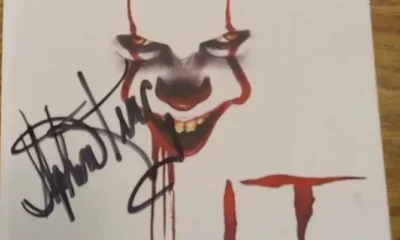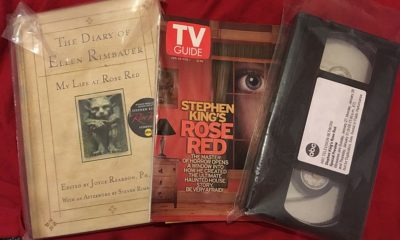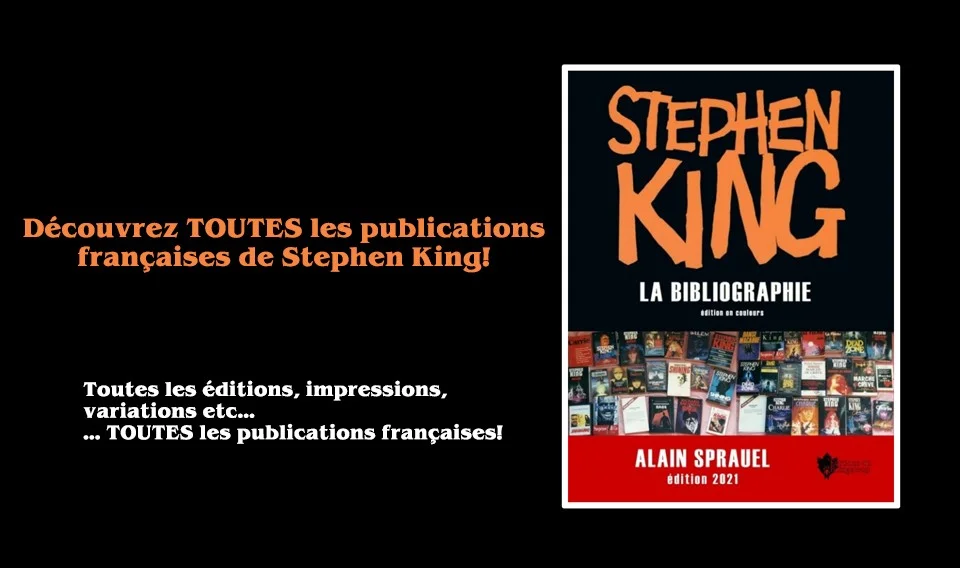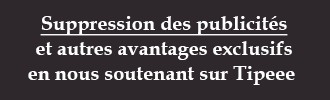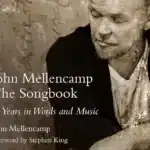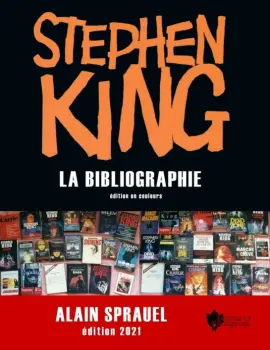- STEPHEN KING – DE L’ECRIT A L’ECRAN
- PANORAMA D’UNE MONSTRUEUSE FILMOGRAPHIE
(2ème partie)
(Guy Astic)
King en raccourcis
Stephen King est prolifique, on ne cesse de le répéter. S’il écrit des pavés, il n’est pas en reste pour les textes courts. Sa poduction totalise près de 70 nouvelles, sans compter les textes inédits et les novellas recueillies dans Différentes Saisons, Minuit 2, Minuit 4. Une manne pour des cinéastes en mal de scénarios, même s’ils ont à résoudre le problème du passage d’une dizaine de pages à un film de durée moyenne. Mais c’est surtout l’occasion d’alimenter d’autres formats cinématographiques ou télévisuels. A ce titre, King est l’héritier incontestable de Richard Matheson et de Robert Bloch, deux figures emblématiques de la nouvelle fantastique ou d’horreur et des courts-métrages ou épisodes en série du même genre.
C’est en 1982 que Stephen King montre combien ses histoires brèves passent remarquablement à l’écran. Il écrit le scénario original de Creepshow, film à sketches devenu depuis la référence. Inspiré, pour sa forme et pour la teneur des gags horrifiques, des bandes dessinées américaines des années 50, les ‘E.C. Comics’, ce long-métrage de près de deux heures bénéficie de la conjonction des talents de King, George Romero et Tom Savini (le maquilleur déjà célèbre de Vendredi 13, Maniac, Le Jour des Morts-Vivants). Le fil directeur entre les histoires prend l’allure d’un dessin animé où l’on voit un jeune garçon (portrait craché de Billy, le fils de King) tout entreprendre pour lire les histoires interdites de l’album Creepshow. Un univers, où le livre support est omniprésent, ce qui n’est pas pour déplaire à notre écrivain. Le format même du film à sketches ne peut que réjouir l’insatiable raconteur: comme le souligne Marcel Burel, cette formule se base sur la tradition des conteurs (12). Et King s’en donne à cœur joie, proposant cinq joyaux d’humour noir, déclinant les thèmes de l’arroseur arrosé ou de ‘tel est pris qui croyait prendre’, de la vengeance comme plat qui se mange froid, même lorsque la chair est avariée! De « La Fête des Pères » à « Çà grouille de partout », en passant par « La Mort Solitaire de Jordy Verrill » (l’action se situe dans la campagne de Castle Rock !), « Un Truc pour se marrer », et « La Caisse », on assiste à un véritable festival de monstres en tous genres (Fluffy la bête millénaire, Nathan Grantham le zombie, Harry et Becky amoureux et morts-vivants, la substance verdâtre proliférante venue de l’espace, la multitude de cafards voraces), de personnages déjantés et de situations grotesques (13). Un cocktail explosif salué comme il se doit à Cannes et dans le monde entier, qui ouvre de nouvelles perspectives…
Creepshow 2 était attendu…sans doute un peu plus tôt. En 1987, Michael Gornick, assistant de Romero – qui apparaît au générique comme co-producteur et scénariste – tourne, à la va-vite semble-t’il, trois histoires inspirées de textes de King, les effets spéciaux étant toujours assurés par Tom Savini. Sont ainsi adaptées « Le Radeau » (Brume) écrit sur le tournage du premier Creepshow et deux histoires inédites, « Le Chef Indien » et « L’auto-stoppeur ». La part consacrée au dessin animé avec The Creep – Tom Savini lui-même sous le masque – et Billy augmente, sans doute pour compenser la faiblesse des courts-métrages, qui lorgnent trop du côté des contes de la crypte. Sans grande nouveauté donc.
Cat’s Eyes (1984), le film à sketches réalisé par Lewis Teague un an à peine après son adaptation de Cujo, rompt avec le ton et la construction des histoires de Creepshow. Les récits de King, « Desintox, Inc » et « La Corniche » (nouvelles recueillies dans Danse Macabre), le script original « Général » n’usent pas du ressort monstrueux – même le troll du troisième volet (conçu par Carlo Rambaldi, ayant réalisé le célèbre E.T.) prête plutôt à sourire. Les intrigues développent des situations extrêmes (marcher sur une corniche autour d’un immeuble, subir une cure de désintoxication avec pénalités physiques) ou la peur enfantine de la créature dans la chambre. L’originalité réside dans le travail de tissage entre les sketches, qui malheureusement est largement tronqué à l’arrivée par le producteur Dino De Laurentiis. King a imaginé le périple d’un chat, qui le conduit dans les lieux de chacune des aventures. Le prologue s’attarde sur les rapports étroits qui lient la toute jeune Drew Barrymore (encore elle !) avec le matou et l’épilogue apporte un infléchissement radical à l’attente entre l’enfant et l’animal : à l’origine, le chat ne parvient pas à sauver la fillette des griffes du troll et la mère, persuadée qu’il est responsable de sa mort, l’abat froidement. Un dénouement étonnant pour un exercice de style tel que le film à sketches, peu avare d’ordinaire des rires grinçants. On s’en doute: cette fin n’a pas été retenue, mais elle suffit à illustrer combien la réversibilté du bien et du mal est omniprésente dans la création de King.
Il n’empêche que chaque petit film fonctionne sans heurts. L’adéquation entre la durée impartie et le déroulement équilibré du récit filmique est parfaite : pas de temps mort ni de précipitation. Les nouvelles de King semblent en quelque sorte avoir trouvé le juste format.
Pour l’heure, le dernier film à sketches consacré à Stephen King est en préparation. Le Québécois Stéphane Clermont a commencé, durant l’été 1997, le tournage d’un tryptique ambitieux, puisant dans trois recueils de l’écrivain américain des récits disparates, inscrits dans des univers sans commune mesure les uns avec les autres : la novella « Le Molosse Surgi du Soleil » (Minuit 4), « Laissez venir à moi les petits enfants » (Rêves et Cauchemars), « Le Raccourci de Mme Todd » (Brume). Il sera intéressant de voir comment le ou les scénaristes parviennent à assurer les transitions entre une histoire dédiée à l’objet maléfique (le polaroïd Soleil 660), celle de la torture mentale ou réelle que subit une institutrice en proie à des visions atroces et celle d’une route pas comme les autres, tour à tour surréaliste, merveilleuse et terrifiante. Un pari osé en tout cas, loin des transpositions faciles des textes coups de poing de Stephen King !
D’autres adaptations ponctuelles de Stephen King intègrent des anthologies fantastiques pour le cinéma ou la télévision. C’est souvent l’occasion pour le producteur de mettre en gros et en lettres d’or ou de sang le nom de King sur l’affiche ou la jaquette vidéo – on comprend pourquoi -, alors que le film ne comporte qu’une histoire du maître ! Citons Contes Macabres, une compilation qui s’ouvre sur « Disciples of the Crow » (1983) de John Woodward, inspiré des « Enfants du Maïs » (Danse Macabre). Un court-métrage insipide, sans dramatisation, ni inspiration. La nouvelle de King n’a décidément pas de chance, comme on le verra par la suite ! On peut préférer dans la même production « Killing Time », tiré de The Late Shift, un texte de Dennis Etchison.
Pour Darkside, Contes de la Nuit Noire (1990), King a écrit « Le Chat de l’Enfer », adapté une fois de plus par George Romero. Une histoire conventionnelle pour une mise en images soignée et sans surprise autour d’un félin pas commode…les chats gris et noirs inspirent décidément notre homme ! De même pour la télévision, Histoires de l’Autre Monde (1985), encore parrainé par George Romero, se prévaut de l’adaptation par Mick Gornick, d’un texte de King, « Machine Divine à Traitement de Texte » (Brume), pourtant bien mal traité à l’écran. Difficile en effet de rendre compte du pouvoir démiurgique de ce professeur, qui en tapant seulement sur les touches de son clavier d’ordinateur, recompose son univers familier et efface ce/ceux qui le gêne (nt) !
D’autre part, toujours pour le petit écran, King fait des incursions dans des séries populaires, même si à l’époque, elles ont tendance à s’essouffler. Pour The New Twilight Zone (La Cinquième Dimension) en 1986, « Mémé » (« Gramma », Brume) est adapté par Harlan Ellison lui-même, versé habituellement dans la science-fiction. Cette histoire d’enfant terrifié par sa grand-mère qu’il doit garder en l’absence de ses parents débouche sur un épisode remarquable, sobre et d’une intensité extrême. En 1987, King écrit un scénario TV original pour Tales from the Darkside : « Désolé, bon numéro », recueilli dans Rêves et Cauchemars. En guise d’anecdote, l’histoire, qui repose sur un paradoxe temporel, et une chute digne des classiques de Twilight Zone, a d’abord été refusée par Steven Spielberg, producteur de Amazing Stories.
Reste à évoquer trois adaptations marginales, peu ou mal diffusées à ce jour. C’est fort dommage, car elles sortent pour ainsi dire du lot. Cela tient d’abord aux récits retenus, tous trois issus de Danse Macabre : « Chambre 312 » (1983), « Le Croque-mitaine » (1986), « Le Dernier Barreau de l’Échelle » (1987). « Le Croque-mitaine » nourrit certes l’imaginaire de King scandé par la peur du ‘méchant loup’ ou du ‘boogeyman’, mais le point de vue est ici celui du père incrédule qui finira vite par déchanter. « Le Dernier Barreau de l’Echelle » narre un évènement tragique – le plongeon dans le vide d’une call-girl – au regard d’un accident similaire survenu aux confins de l’enfance et « Chambre 312 » est empreint d’une spiritualité aussi bouleversante que l’acte décrit : l’euthanasie. Autre point commun : King a cédé ses textes sans réclamer l’ombre d’un dollar aux réalisateurs chanceux. Il faut dire que ces derniers étaient des étudiants passionnés, mais les poches vides. L’un d’entre eux s’est bien rattrapé depuis : Frank Darabont, aux commandes de « Chambre 312 », a par la suite écrit le script de The Blob (1988), co-scénarisé Mary Shelley’s Frankenstein de Kenneth Branagh (1994), réalisé Les Évadés et plus récemment, La Ligne Verte… sans oublier l’adaptation de Brume qui est pour lui un projet sérieux. Si Jeff Schiro n’a pas connu la même carrière que son prédécesseur, il a su ravir King par la mise en scène de sa nouvelle. Ce n’est pas rien ! Quant à la troisième réalisation, elle demeure confidentielle puisque le film n’a pas été distribué. Cependant, la nouvelle suscite encore des convoitises, si l’on en croit une information en provenance du Maine : Lucas Knight et sa société EDGE Productions ont acquis les droits pour « Le Dernier Barreau de l’Échelle » et sont en passe de monter un téléfilm pour une chaîne locale.
Les textes courts de Stephen King provoquent une frénésie sans pareil du côté des professionnels de l’image. Et l’effervescence n’est pas prête de retomber. Le 6 juin 1997, la série The Outer Limits proposait une version de la nouvelle « Les Révélations de Becky Paulson » (texte repris dans Les Tommyknockers et disponible dans 22 Histoires de Sexe et d’Horreur paru chez Albin Michel). On parle d’une possible adaptation de « La Saison des Pluies » (Rêves et Cauchemars) pour Tales from the Darkside 2 – la direction d’acteurs sera difficile : comment maîtriser une nuée de crapauds tombée du ciel ?! Les images de synthèse ? Par ailleurs, Mick Garris baserait son film TV pour la Fox, Quicksilver Highway, sur « Dentier Claqueur » (Rêves et Cauchemars). Enfin, King ne renonce pas à imaginer des scénarios de court-métrages : son projet le plus attractif serait d’écrire un épisode de la cinquième saison des X-Files. Si les rumeurs se confirment, l’écrivain aura à franchir un pas : se soumettre au moule bien défini par Chris Carter, quoique certains loners de la célèbre série ne soient guère éloignés de l’univers de King – la paranoïa en moins !. A suivre donc…
King et la mini-série TV
Après le short King, voici venir la version longue. Sans doute la contribution la plus originale de l’écrivain, dont une part non négligeable de sa réputation coïncide indéniablement avec un format TV dont il a impulsé le renouveau : la mini-série.
La mini-série est un compromis entre le serial, grand roman-feuilleton cinématographique puis télévisuel (14) et le téléfilm fleuve. Elle navigue entre trois heures et huit heures de diffusion, joue des cliffhanger (suspense de fin d’épisode), multiplie les personnages – avec des seconds rôles forts – recourt aux récits enchâssés ou aux intrigues annexes. Des éléments, on s’en doute, en parfaite symbiose avec les romans démesurés de Stephen King. En fait, le changement de codes (de l’écrit à l’écran) a le mérite de mettre en valeur les techniques fictionnelles dont use – abuse ? – l’écrivain. Notamment la dramatique éprouvée et pourtant attendue dans ses livres, qui s’impose de façon naturelle dans la sérialisation télévisuelle. En somme, King gagne à être adapté dans ce format. Son penchant à l’agencement détaillé et progressif du cadre narratif et des relations humaines y est respecté. Il prend son temps pour installer une communauté ou un ordre du réel dont les ramifications et les fondements sont largement représentés. Ce travail accompli, le renversement des normes et l’écroulement du milieu désormais familier pour le lecteur peuvent commencer. Une démarche qui trouve sa meilleure expression dans la mini-série. En revanche, l’exploitation télévisuelle s’accompagne d’une perte pour les textes de King : sur le petit écran et aux heures de grande fréquentation, l’horreur est allégée, les images choc écartées. Ce qui parfois donne une impression de décalage entre la nature de l’horreur déployée et les actes de violence proprement dit.
Les Vampires de Salem en 1979 inaugure de belle manière l’arrivée de King à la télévision. Le roman est plutôt court, ce qui n’empêche pas une transposition filmique de près de quatre heures… au reste, le jeune auteur n’a pas encore écrit les sommes qu’on lui connaît. Il y a de toute façon matière à une pareille adaptation, tant les motifs fantastiques traditionnels et modernes ne manquent pas : vampirisme, maison hantée, contamination du Mal, peurs de l’enfance, l’écrivain entraîné dans une réalité qui dépasse la fiction. De plus, la mini-série, par sa longueur et son tempo, traduit la lente et inéluctable désintégration de la ville de Salem.
Stirling Stilliphant s’est chargé du script et Tobe Hooper de la réalisation. Un duo gagnant pour la version cathodique, même si elle n’est pas parfaite. Ils ont su pour le coup créer un show terrifiant plutôt inédit, qui jongle avec les références (l’allure très Nosferatu du vampire, l’ambiance de Je suis une légende de Richard Matheson) et propose une mise en images d’une qualité supérieure à ce qui se fait d’ordinaire sur les chaînes. Fort du succés des Vampires de Salem, Warner Brothers commercialisent une version cinéma. C’est une catastrophe ! Le passage à deux heures de film mutile le produit original : les ellipses rendent invraisemblables les agissements des personnages : la tension retombe la plupart du temps. Pire, en 1987, Larry Cohen tourne une sequel inintéressante, Les Enfants de Salem, exploitant sans vergogne le nom de King pourtant à mille lieues du projet.
La version télé est donc plus aboutie, même si King souligne que le résultat aurait pu être meilleur avec une ou deux heures supplémentaires, surtout pour mieux camper les personnages, dissocier par exemple les traits de caractère du professeur et du prêtre (15). Or, malgré la réussite de cette première, il faudra attendre dix ans avant de voir une nouvelle mini-série inspirée du maître. La raison est simple : la passion du public pour les livres de King est telle que leur exploitation cinématographique est quasi-immédiate. Et les textes en question nécessitent le format standard grand écran. Il y a bien Le Fléau qui attend depuis 1979 ; George Romero a des vues sur l’énorme roman, mais il fait encore peur. Patience…
CA relance la machine. Publié en 1986, le roman est immédiatement un best-seller. Il représente une sorte d’anthologie de toutes les peurs et les situations horrifiques que l’écrivain avaient décrites jusqu’à présent. Or, le grand avantage pour une future adaptation, c’est que la structure narrative repose sur un double mouvement : la confrontation de sept gamins avec Grippe-Sou dans les années 50, et la lutte des six rescapés avec la chose de nouveau réveillée trente ans plus tard. A l’intérieur de cette organisation d’ensemble, King raconte l’histoire de chacun des protagonistes, à l’âge pubère et dans les années 80. Un fil directeur qui n’échappe pas au scénariste Lawrence D. Cohen, dont le travail pour le film de 1990 tourné par Tommy Lee Wallace, consistera en un savant élagage et en un resserrement linéaire débarrassé de nombreux flash-back. Les intermèdes concernant Derry et consignés dans le journal de Michael Hanlon sont ici écartés.
A plusieurs reprises, le réalisateur souligne la fusion naturelle du livre avec les formats habituels de la télévision américaine, allant même jusqu’à parler des sept pauses publicitaires qui délimitent au mieux les récits propres aux sept personnages (16). La mini-série est diffusée en diptyque, deux heures par épisode, un découpage fidèle au rythme du livre. La déception ? Elle existe et elle est de taille : le final. Toutes les aventures convergent vers l’antre de la Chose, imaginée sous la forme d’une araignée géante. Rien de plus normal au regard du roman. Mais le combat ultime, sous la plume de King, renvoie à une lutte immémoriale, voire cosmique, avec une entité pas seulement arachnéenne, dont la dénomination la plus juste est Les Lueurs Mortes. Une dimension qui disparaît totalement dans l’adaptation. Finir sur la Chose échappée d’un mauvais remake de Tarantula (1955) de Jack Arnold, sans autre perspective, çà fait kitsch ! Le charme retombe lourdement ! Rideau…
Rendez-vous est pris dorénavant. Presque chaque année, un livre de Stephen King se métamorphose en mini-série TV. Quand le texte manque, l’écrivain se fait un plaisir de rédiger une histoire si possible délayée. C’est le cas pour Contretemps (Golden Years) créé tout spécialement pour CBS, dont l’objectif est de tenir en haleine les spectateurs durant l’été 1991, avec plus de huit heures de film ! Pari commercial tenu, mais le résultat est médiocre. Elle est bien poussive cette intrigue d’un vieillard contaminé par des radiations à la suite d’une explosion dans un laboratoire secret. Rien d’exaltant dans la poursuite qui s’engage entre le protagoniste tout heureux de vivre une régénération miraculeuse et une agence gouvernementale impitoyable. Seule satisfaction : la justesse psychologique avec laquelle King dépeint le vieillissement, perceptible aussi dans Insomnie, le roman dédié au troisième âge !
Rien ne vaut en définitive un roman de King ! Les Tommyknockers, adapté en 1992 par John Power, tire son épingle du jeu. Mieux, la mini-série dépasse le livre, le moins réussi de King il est vrai. Elle recycle avec bonheur l’atmosphère paranoïaque de séries telles que V ou celle plus opressante encore de L’Invasion des Profanateurs de Siegel ou Kaufmann. Les éclairages – un vert entêtant – et la photographie (Dan Burstall et David Eggby) ont une influence déterminante et les effets spéciaux sont utilisés avec parcimonie.
Avec Le Fléau de Mick Garris en 1993, on atteint des sommets. Jamais une mini-série n’avait présenté un spectacle aussi total, une épopée post-moderne – avec tous les prolongements mythiques imaginables – à la (dé)mesure du livre. Plus de six heures de diffusion, des destinées qui ne cessent de se croiser, un univers en perdition, une lutte apocalyptique entre le Bien et le Mal, pour lesquels le réalisateur et son équipe ont su donner des visages convaincants. Et ce corbeau qui hante les images, manifestation des préférences de l’écrivain (Poe entre autres) et point de vue démiurgique ultime dans un crépuscule des dieux nietzchéen – les principes apollinien et dyonisiaque ont droit de cité dans l’oeuvre de King, ne l’oublions pas !
L’engouement pour la mini-série fantastique est tel ces derniers temps, que les producteurs poussent à adapter des textes dont l’ampleur, à priori, ne correspond pas au format voulu. Ainsi en 1995, Tom Holland tourne, à partir de son propre scénario, Les Langoliers. Un choix qui peut surprendre : c’est une novella (extraite de Minuit 2). Comment dès lors obtenir plus de trois heures de diffusion sans lasser les téléspectateurs ? Malgré quelques longueurs et la représentation saugrenue des créatures, le produit final convainc. Cela tient en fait à la narration minutée du texte de King, propice à l’expression du suspense. Or, le suspense ne demande qu’à durer. Le public est servi : l’imminence toujours retardée du surgissement des Langoliers avaleurs de mondes semble ne jamais finir. Le grignotement de morceaux d’univers, les bruits qui l’accompagnent, sont poussés à l’extrême… et notre patience est à bout. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose !
Dernière réalisation en date : The Shining (1997) de Mick Garris ou la revanche de Stephen King sur Stanley Kubrick ! L’écrivain avait toujours reproché au réalisateur d’avoir dénaturé son livre avec un film nerveux, saturé et étroit aux entournures. Voilà le préjudice réparé : King a concocté un volumineux scénario (de plus de 300 pages !) sur mesure selon lui, qui fait la part belle à la durée et à la longue descente aux enfers de la famille Torrance (17). Et pour nous, cinéphiles, c’est l’occasion de se lancer dans les comparaisons et les débats houleux, pour savoir laquelle des deux adaptations est la plus réussie ou la plus fidèle à l’esprit du roman, sachant que King ne détient pas forcément la vérité en ce qui concerne Shining. Après tout, le livre est désormais la propriété des lecteurs et des spectateurs, qu’on se le dise !
Pour clore le chapitre, voici les inévitables projets d’adaptation. L’adaptation de La Ligne Verte, seul roman-feuilleton de King, a été confiée à Frank Darabont. Autant dire que la conception de la mini-série, située pour la majeure partie dans le bloc des condamnés à mort, bénéficiera de l’expérience du réalisateur des Evadés, qui filme au mieux l’univers carcéral et les bouleversements psychologiques liés à ce milieu. On ressortirait en outre du placard et des oubliettes cinématographiques Charlie, sous un format qui de toute façon ne sera pas pire que le traitement que lui a fait subir Mark Lester ! Insomnia est en ligne de mire et le nom de David Fincher est avancé, metteur en scène dont la côte est au plus haut depuis Alien 3 et Seven. Rose Madder est aussi prévu pour le petit écran, reste à savoir sous quelle forme, téléfilm ou mini-série. Par contre, Kathy Bates est plus que pressentie pour jouer le personnage principal, voire pour se lancer dans la réalisation. L’actrice aime King, à n’en pas douter : rôles titres dans Misery et Dolores Claiborne, apparition dans Le Fléau, lecture audio d’une nouvelle de Rêves et Cauchemars. On l’a remarqué : King en images, c’est un peu une histoire de famille, les mêmes noms reviennent souvent – Romero, Bates, Darabont, Rubinstein, Garris, Reiner, etc. ! Enfin, l’écrivain a l’intention de préparer pour ABC une histoire intitulée Storm of the Century (rien que ça !) qui fera l’objet d’une mini-série de six à huit heures. Espérons qu’il ne réitèrera pas la mauvaise surprise de Contretemps !
Les Films de lèse-majesté
Dernière ligne droite, qui s’apparente à un chemin de traverse bien mal fréquenté ! Il nous reste à voir les impostures sur grand et petit écran liées à Stephen King. Phénomène littéraire et cinématographique, l’écrivain a le don d’engranger les dollars et utiliser son nom équivaut souvent à une pluie de billets verts ! Dès lors, les scrupules disparaissent et toutes les occasions sont bonnes pour multiplier les petits King…
Démonstration avec le sort réservé à une nouvelle de Danse Macabre, « Les Enfants du Maïs ». En 1984, Fritz Kiersch réalise une adaptation bâclée. Qu’à cela ne tienne, le sujet est porteur et suffisamment gore -une communauté d’enfants qui tue tout adulte qui fait intrusion dans leur village. En 1991, David F. Price tourne Les Enfants du Maïs 2, Le Sacrifice Final. Exécrable ! Mais à partir de là, la suite des Démons du Maïs est rebaptisée Horror Kids, pas loin des Ninja Kids, c’est dire ! En 1994 sort Les Moissons de la Terreur (soit Horror Kids 3) de Hickox – qui n’est pas le plus lamentable. Actuellement se prépare Horror Kids 4 ! Comment, en somme, épuiser le filon en se réclamant de Stephen King, dont l’esprit du texte a été trahi dès le premier opus !
Autre exemple : Tom McLoughlin adapte en 1991 la nouvelle « Cours, Jimmy, Cours » (Brume). Vengeance Diabolique/Sometimes They Come Back se laisse regarder, même si la transposition est particulièrement libre, brodant autour de l’histoire d’un professeur en proie au retour (concret) d’anciens démons. Tim Matheson en Jim Norman assure au long métrage une certaine qualité. Le pire est toutefois à venir. En 1996, circule en vidéo Les Enfants du Diable, distribué sous le label King. En américain, le long-métrage s’intitule Sometimes They Come Back… again. Guy Riedel et Adam Grossman (le réalisateur) ont signé un scénario soi-disant inspiré de la nouvelle déjà évoquée, titre auquel ils ont ajouté ‘again’. Ben voyons ! Rien dans le film ne rappelle le texte original de King : on assiste à une compilation de scènes d’horreur sans grand intérêt (la mine, la tondeuse, des cartes à jouer tranchantes, un cochon égorgé). Pas de quoi fouetter un chat ! A ignorer donc.
Restent deux films de science-fiction, honorables, mais peu honnêtes envers les textes souches de Stephen King. D’abord Running Man (1987) de Paul Michael Glaser (alias Starsky) inspiré du livre de Richard Bachman. Si le livre ne fait pas dans la finesse avec le récit d’une traque futuriste, le film met les deux pieds dans le plat. Et quand on sait qu’ils appartiennent à Arnold Schwarzenegger, cela tourne au cataclysme ! Le scénariste Steven E. de Souza a jugé bon d’évacuer tous les passages grinçants (Bachmann décrit en fait une dystopie) sans rapport direct avec l’action proprement dite. Dès lors, place au divertissement, à la castagne version jeux du cirque en l’an 2017. On a connu Schwarzie plus inspiré depuis en combinaison high tech dans Total Recall notamment ! Et mieux vaut se projeter Le Prix du Danger.
Dernier camouflet, le plus retentissant, parce que Stephen King a vu rouge ! Il a attaqué en justice Brett Leonard, réalisateur d’un long-métrage plutôt novateur, Le Cobaye (1991), sur les affres de la réalité virtuelle. Tout cela pour une histoire de tondeuse à gazon ! Le nom de l’écrivain crève l’écran au générique, seulement pour trois malheureuses minutes, une scène gore gratuite… ce qui n’est pas pour ravir King. On y voit un homme poursuivi et déchiqueté par une tondeuse dirigée à distance -échappée en fait de « La Pastorale » (Danse Macabre). Rien de plus !
Un homme averti en vaut deux. Quand vous lisez au générique ou sur la jaquette vidéo « d’après une histoire de Stephen King », méfiez-vous ! King ne maîtrise pas toutes les adaptations faites en son nom et il en laisse parfois passer pour des histoires évidentes de gros sous. Qu’il le veuille ou non, il est devenu un produit de consommation courante. Aussi n’est-il pas à l’abri des avaries et des exploitations outrancières.
Pour résumer une pareille filmographie -une gageure -, trois mots s’imposent : succès, fidélité, excès. Le succès de King sur petit et grand écran ne tient pas forcément à sa participation directe au transfert de ses oeuvres. Il s’explique surtout par l ‘attention que l’écrivain porte à l’histoire : » L’histoire prime toute autre considération en matière de fiction ; l’histoire définit la fiction et tout le reste « (18). Cette matière première qui, d’une façon ou d’une autre, enchante les spectateurs, même quand le produit fini est en-deçà des textes eux-mêmes. D’autre part, King peut compter sur la compréhension de plusieurs réalisateurs, producteurs ou scénaristes qui lisent de près ses récits et tentent d’en restituer, avec une fidélité qui les honore, à la fois la lettre et l’esprit. Ils ont ainsi saisi à quel point King était, au sein même de son écriture, un amoureux de la télévision et du cinéma, un ‘story-movie teller’ – illustration récente et explicite avec Les régulateurs, sous le pseudonyme de Richard Bachman, à l’origine un scénario pour Sam Peckinpah. Enfin, la filmographie tous azimuts de King montre combien cet auteur est versé dans la démesure, dans le méli-mélo imaginaire sans réelles bornes. Cette absence de frontières favorise les excès, les pires comme les meilleurs.
C’est le prix à payer pour une création qui se soustrait à toute hiérarchie ou à tout ordre de valeurs, encore plus à l’écran qu’à l’écrit. King est définitivement un inclassable : il est à l’origine de grands films d’autuer et de réalisations qu’on a peine à ranger parmi les films de série Z ! Entre les deux, un gouffre sur lequel plane l’ombre immense du géant de Bangor !
Université de Provence (Aix-Marseille I)
Note de la rédaction: vous trouverez dans le prochain numéro du Rag une liste exhaustive des adaptations de King au cinéma et à la télévision, des apparitions de King à l’écran , suivie d’une bibliographie…
12 M. Burel, » Le fantastique en tranches du film à sketches « , p. 132-37, in Le cinéma fantastique, CinémAction n°74, coll ection ditigée par Guy Hennebelle, Corlet-Télérama, 1er trimestre 1995.
13 Lire le dossier complet préparé par Paul R. Gagne pour Cinéfantastique, vol.13, n°1, September-October 1982, p.16-35.
14 Lire à ce propos » Un maître du serial: William Witney « , par Pierre Gires, Fantastyka, n°12, mars 1997, p.4-18.
15 Interview accordée à David Chute (1980), in Feast of Fear op. cit., p.73.
16 Propos recueillis par Jack Tewksbury dans Mad Movies, n°68, novembre 1990, p.45.
17 Pour plus de renseignements, lire Mad Movies n°107, mai 1997,p.46-49 et l’interview recueillie par Luaine Lee Knight-Ridder, The Province, April 22, 1997.
18 S. King, Pages Noires, Editions du Rocher, 1995, p.101.